La DORA en milieu universitaire : un levier pour réinventer l’évaluation de la recherche?
Alors que peu d’universités canadiennes ont signé la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche, ses principes influencent de plus en plus les pratiques d’embauche, de financement et d’avancement académique.

Deux ans après sa nomination au sein du corps professoral à l’Université de Winnipeg, le physiologiste de l’exercice Yannick Molgat-Seon a demandé le renouvellement de son financement auprès du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). « L’organisme mettait l’accent sur sa récente signature de la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche », raconte-t-il. Ne connaissant pas celle-ci, qu’on surnomme DORA, il s’est renseigné. « J’ai aimé ce que j’ai lu, et comme mon financement dépend de cet organisme, j’ai décidé de signer la déclaration moi-même. »
Créée en 2012, la DORA est un ensemble de principes visant à élargir la manière dont la recherche universitaire est évaluée, en accordant moins de poids aux critères traditionnels, comme le facteur d’impact (soit l’évaluation des activités de recherche selon le nombre et le type de publications dans des revues). Selon l’énoncé de mission, la DORA encourage les établissements à prendre en compte un éventail de mesures de l’incidence, « dont les indicateurs qualitatifs comme l’influence sur les politiques et les pratiques. »
LIRE AUSSI : La Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche gagne du terrain au Canada
L’Université de Winnipeg n’a pas signé la DORA, mais les chercheuses et chercheurs peuvent y adhérer individuellement; en fait, des 981 signataires de la DORA provenant du Canada, on ne compte que sept établissements d’enseignement supérieur. L’Université de Calgary a été la première à la signer en 2021, suivie de trois établissements du Québec : l’Université de Sherbrooke, l’Université de Montréal et l’École de technologie supérieure (ÉTS), qui fait partie du réseau de l’Université du Québec. L’Université de Victoria et l’Université Mount Allison y ont adhéré au printemps dernier, et l’Université Concordia, en décembre.
Les organismes subventionnaires fédéraux, soit le CRSNG, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), l’ont signé conjointement en 2019, soulignant que la DORA concorde avec leurs politiques existantes sur le libre accès aux publications et leur plan d’action pour l’équité, la diversité et l’inclusion.
L’Université de Calgary avait eu un raisonnement similaire, raconte William Ghali, vice-recteur à la recherche. « La DORA avait gagné beaucoup de terrain dans le milieu », précise-t-il, ajoutant que la direction de l’université travaillait à élaborer un cadre d’évaluation de la recherche qui mettait en valeur l’engagement auprès de l’ensemble de la collectivité.
« La DORA ne diminue pas l’importance des publications ou des articles savants traditionnels. Elle met plutôt en lumière les diverses retombées des travaux de recherche. »
Dans ce contexte, le Dr Ghali explique que la DORA sert de guide aux chercheuses et chercheurs, les aidant à internaliser cette philosophie et à voir leurs travaux sous un nouveau jour. « Selon nous, la DORA repose sur la manière dont les universitaires évaluent leur propre travail. Notre propre cadre d’excellence de la recherche donne aux chercheuses et chercheurs la responsabilité de nous raconter ce qu’elles et ils ont fait de leur travail. »
La direction de l’Université de Calgary a intégré la DORA aux processus d’embauche, d’avancement et d’attribution des subventions, encourageant les chercheuses et chercheurs à appliquer les principes dans leurs demandes. Le Dr Ghali raconte que d’autres leaders et lui ont voulu promouvoir la DORA auprès des décanats, mettant en lumière son vaste champ d’application. « La DORA ne diminue pas l’importance des publications ou des articles savants traditionnels, nuance-t-il. Elle met plutôt en lumière les diverses retombées des travaux de recherche. »
Christie Hurrell, bibliothécaire associée spécialisée en soutien à la recherche à l’Université de Calgary, a travaillé étroitement au déploiement de la DORA; son travail supposait en partie d’expliquer que la déclaration ne visait pas à remplacer quoi que ce soit. « Elle ouvre la porte à d’autres avenues, plutôt que de forcer les personnes satisfaites du système actuel à changer leurs façons de faire », explique-t-elle. Elle ajoute que d’autres bibliothécaires et elle connaissent depuis longtemps les lacunes du facteur d’impact, qui a été initialement élaboré comme un outil permettant aux bibliothécaires de catégoriser les abonnements aux revues.
De toutes les disciplines, la science a toujours considéré les publications comme la norme par excellence, ce qui explique en partie pourquoi la DORA a été établie par des universitaires du milieu scientifique. À l’Université de Sherbrooke, Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche, dit qu’il s’attendait à rencontrer une opposition de la part de ses collègues scientifiques, mais que plusieurs ont plutôt accueilli volontiers le changement. Il a entendu beaucoup de commentaires qui ressemblaient à : « Le nombre d’articles publiés ne m’intéresse pas. Je veux connaître les retombées concrètes de vos travaux sur la société. »
M. Perreault donne l’exemple de Réjean Hébert, un gériatre réputé et ancien professeur à l’Université de Sherbrooke, qui a élaboré le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle, un outil diagnostique permettant d’évaluer les besoins des personnes âgées. « Son travail a fait l’objet d’un article de revue dont le facteur d’impact est de deux. Or, quelque 20 millions de personnes utilisent chaque année ce questionnaire partout dans le monde. »
À l’instar du Dr Ghali, M. Perreault ajoute que la DORA a eu des retombées concrètes sur l’embauche et l’avancement dans son établissement, ce que la direction d’autres universités ayant signé la déclaration observe aussi.
« Elle aide les têtes dirigeantes à prendre en compte l’éventail complet des retombées des activités de recherche », explique Richard Isnor, vice-recteur principal et vice-recteur aux études et à la recherche à l’Université Mount Allison. Dans cet établissement de petite taille, où il est courant que les membres du corps professoral de diverses disciplines évaluent les candidatures, M. Isnor explique que la DORA sert de guide pour uniformiser les processus d’avancement. La DORA contribue également à faire mieux connaître l’ensemble des travaux. « Les universités de petite taille comme la nôtre doivent mettre les bouchées doubles pour que les travaux de leurs universitaires soient traités équitablement par les chercheuses et chercheurs, ou par le milieu scientifique des universités de plus grande taille, où les attentes sont différentes. »
M. Molgat-Seon convient que la DORA contribue à la gestion des attentes à l’égard du corps professoral dans les universités de petite taille, où les ressources pour la recherche sont parfois moindres, et les responsabilités d’enseignement, souvent accrues. « Au lieu d’adopter la populaire mentalité de la “publication à tout prix”, j’ai décidé de produire moins d’articles, mais de me concentrer sur leur qualité et sur la transmission de l’information », explique-t-il.
Puisque relativement peu d’universités ont signé la déclaration, rien ne garantit que l’ensemble du milieu de l’enseignement supérieur en viendra à évaluer les activités de recherche d’après les principes de la DORA. Et même pour les signataires, la DORA n’a pas force exécutoire.
Mais M. Isnor, qui a travaillé pendant plusieurs années au CRSNG, estime qu’elle représente le levier d’un changement à grande échelle. « Elle sert une fonction d’information et de sensibilisation, et c’est l’un des moyens d’action qu’utilisent les organismes et les gouvernements. Cela nous aide, en tant qu’établissements, à transmettre l’information et à expliquer pourquoi nous l’avons signée. Elle reflète un engagement envers certains principes. »
Pour Christie Hurrell de l’Université de Calgary, la DORA est à la croisée des chemins. « Elle se trouve entre la promotion descendante de ces nouvelles idées, et les tensions qu’elles suscitent chez les personnes qui tentent de se retrouver dans un système qui change sans préavis. »
Postes vedettes
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (autochtone, programme anglophone)Université d'Ottawa
- Chaire de recherche, niveau 2 dédiée à l’étude de la motivation et du mieux-être au travailUniversité du Québec à Trois-Rivières
- Doyenne ou doyen, Faculté d’éducationUniversité de Sherbrooke
- Vice-rectrice ou vice-recteur à la formation et à la rechercheUniversité du Québec à Rimouski
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (didactique de l’activité physique et sportive, santé et bien-être - poste francophone)Université d'Ottawa

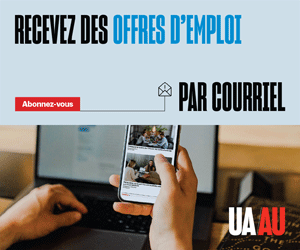

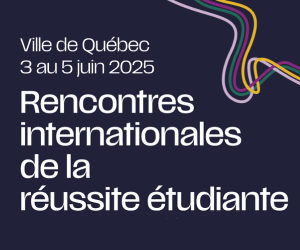







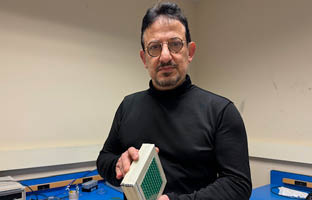
Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.