La recherche dans les universités de la francophonie canadienne : un élan dynamisé par les chaires fédérales
Depuis 20 ans, les chaires de recherche du Canada ont propulsé la recherche dans les universités francophones minoritaires, mais des défis demeurent pour garantir leur pérennité et leur financement.

La recherche dans les universités de la francophonie canadienne en situation minoritaire est aujourd’hui foisonnante. Depuis une vingtaine d’années, elle s’est dynamisée, autour des Chaires de recherche du Canada.
Une chaire vise à stimuler la recherche, faire avancer les connaissances, valoriser et promouvoir une discipline et former une relève. Il s’agit d’un poste octroyé à un chercheur, une chercheuse, afin de poursuivre des recherches dans une discipline. Plusieurs types de chaires existent au Canada : des chaires institutionnelles, des chaires de recherche du Canada, des chaires Senghor de la Francophonie et des chaires de l’UNESCO. Une chaire peut être de notoriété nationale ou internationale, permanente ou temporaire.
Sur les 2 285 chaires du Canada inscrites sur le site du gouvernement fédéral, les établissements de langue française en situation minoritaire en ont sept : à l’Université de Moncton, à l’Université Sainte-Anne et à l’Université Saint-Boniface.
Dès qu’elles ont eu accès au programme fédéral lancé en 2000, les universités de la francophonie canadienne ont créé des chaires, du Campus Saint-Jean à Sainte-Anne en passant par l’Université de Hearst.
Parallèlement, certaines institutions ont instauré leurs propres chaires. C’est le cas de l’Université d’Ottawa, avec la première version du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, aujourd’hui regroupant 10 chaires.
Évidemment, des structures existaient bien avant : des centres de recherche, comme l’ancêtre du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes et le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest, ainsi que de nombreuses revues savantes.
Une recherche qui a explosé
Dans un article paru dans la revue de l’ACFAS, Linda Cardinal a analysé les revues savantes et leurs contenus depuis 1962.
« La recherche s’inscrit dans un contexte », qu’on soit en francophonie minoritaire ou pas, observe d’entrée de jeu la vice-rectrice adjointe à la recherche et professeure à l’Université de l’Ontario français, à Toronto. « Et pour nous, ce contexte-là est plus étroitement lié au débat constitutionnel et à la Loi sur les langues officielles. »
La recherche a d’abord porté sur les lettres et l’histoire. Mais au tournant des années 1970, elle s’est ouverte aux sciences sociales, à la sociologie, à la science politique. Petit à petit, les sujets se sont décloisonnés et la recherche s’est complexifiée, écrit-elle.
L’immigration, le droit, la santé et l’éducation, les services sociaux et les politiques publiques passent sous la loupe. Elles permettent « d’améliorer les politiques et la qualité de vie, le bien-être des communautés francophones », remarque-t-elle.
Le financement accru de la recherche, notamment par l’avènement des chaires de recherche du Canada, a suivi. Ce qui a « fait exploser » la recherche, estime Yves Frenette, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones de l’Université de Saint-Boniface. Souvent, au profit de la collectivité dans son ensemble.
Selon l’ACFAS :
- Plus de 4 175 membres du corps professoral et personnes chargées de cours francophones travaillent en francophonie minoritaire et en Acadie.
- 8 % des revues savantes créées au Canada depuis 1960 sont en français (17 % sont bilingues). « Les revues sont dorénavant de véritables leviers qui permettent de poursuivre le travail de synthèse de la recherche en milieu minoritaire », écrivait Linda Cardinal en 2022.
En raison des retombées de la recherche, les petits établissements francophones la valorisent. Cependant, la concurrence des grandes institutions anglophones qui proposent un éventail de programmes force les administrations à prioriser le recrutement des étudiantes et étudiants.
La viabilité financière des universités de la francophonie canadienne reposant sur leurs effectifs, elles compteront sur le leadership des professeures et professeurs en matière de recherche, affirme Mme Cardinal.
De plus, les établissements de la francophonie canadienne peinent à accéder au financement de la recherche, plaide Sophie Bouffard, rectrice de l’Université de Saint-Boniface. « Il existe déjà des mécanismes reconnaissant la particularité des établissements de plus petite taille », admet-elle. Si elle est satisfaite « des belles choses » qui se font dans son établissement, elle estime qu’il y a encore du travail à faire « pour pouvoir nous donner les coudées franches ».
La norme est toujours dictée par les grands réseaux scientifiques et les grandes universités, affirme Mme Cardinal. Elle illustre avec deux exemples : d’une part, les revues des petits établissements d’enseignement, dont la production repose « sur les épaules de gens engagés », ne sont pas automatiquement financées par les conseils de recherche. D’autre part, les chaires, soumises aux mêmes attentes en matière de productivité. La recherche « n’est pas ‘rentable’, mais c’est un investissement dans le futur», poursuit-elle, tant pour les établissements que pour les communautés.
Des retombées décuplées
Clint Bruce est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse. Il qualifie la force de frappe des petits établissements de la francophonie canadienne de puissante. « Moncton, Sainte-Anne ont un impact démesuré par rapport aux grands centres de recherche », croit-il. « Ça transforme l’environnement institutionnel ».
Les possibilités de recherche l’ont attiré à Sainte-Anne. Occupant autrefois des postes où l’enseignement était privilégié, l’idée « de pouvoir élargir [ses] horizons de recherche et d’avoir plusieurs chantiers – plusieurs périodes en histoire, de faire du terrain, aussi » lui souriaient.
Aujourd’hui, il a créé un observatoire, où les étudiantes et les étudiants participent activement à la recherche, et ce, dès le premier cycle.
Son travail n’a pas échappé à l’attention de son collègue du Manitoba, M. Frenette : « Une véritable révolution est en cours dans l’étude acadienne et c’est en partie grâce à cette chaire.»
Depuis 20 ans, les chaires ont contribué à l’essor des francophonies canadiennes. Déjà « entrepreneures », les personnes chercheures devenues titulaires de chaires ont poursuivi leur travail de recherche, de demandes de financement, de formation, de publication, d’échanges.
Les chercheurs et chercheuses aimeraient disposer de plus de moyens, motivés par leur fort appétit pour la collégialité. « Un titulaire de chaires n’est pas seulement un bon chercheur, mais aussi un ou une bonne animatrice », croit M. Frenette. « Il faut avoir des gens autour de soi. »
Postes vedettes
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (autochtone, programme anglophone)Université d'Ottawa
- Doyenne ou doyen, Faculté d’éducationUniversité de Sherbrooke
- Vice-rectrice ou vice-recteur à la formation et à la rechercheUniversité du Québec à Rimouski
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (didactique de l’activité physique et sportive, santé et bien-être - poste francophone)Université d'Ottawa
- Doyenne ou doyen - Faculté de génieUniversité de Sherbrooke

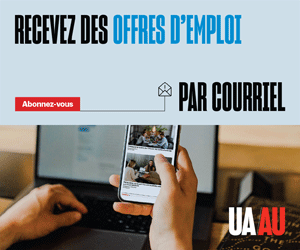

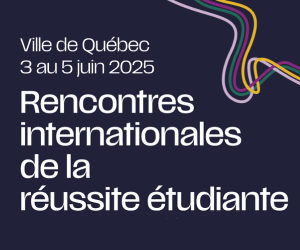







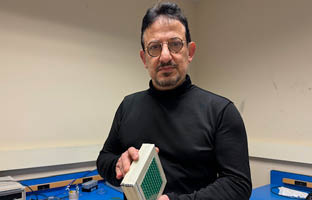
Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.