Les activistes en résidence, une richesse et un défi pour les universités
De nouveaux programmes émergent un peu partout au pays, mais on peine à les financer.

Avant de devenir activiste en résidence pour l’initiative de recherche en milieu communautaire (Community-Engaged Research Initiative ou CERi) de l’Université Simon Fraser au début de 2023, Wendy Pedersen ne savait pas trop quoi penser de l’aspect « résidence » du poste.
Les bureaux de la CERi sont situés dans un espace de travail partagé, dans le Downtown Eastside de Vancouver. Une décennie plus tôt, Mme Pedersen avait milité pour que l’endroit – alors une ancienne station de police – soit transformé en logements sociaux. La campagne, qui n’avait malheureusement pas porté fruit, avait été riche en émotions et marquée par la grève de la faim d’un ami.
« Je n’avais jamais mis les pieds dans le nouveau bâtiment. J’avais un peu l’impression d’être une traîtresse », confie-t-elle.
Mais après avoir franchi la symbolique ligne rouge, Mme Petersen s’est laissée charmer par l’endroit et ses commodités, dont une photocopieuse et des salles de réunions; tout un changement après 30 ans de militantisme communautaire les mains pratiquement vides. « Avoir accès à des ressources qui nous aident à effectuer notre travail, c’est très précieux. »
Durant son mandat de quatre mois avec l’Université Simon Fraser, elle a notamment effectué de la recherche sur la diminution des logements pour une personne à Vancouver. Un mois après la fin du mandat, la Société collaborative de logements pour une personne du Downtown Eastside (Downtown Eastside SRO Collaborative Society), dont elle est fondatrice et directrice générale, a reçu 11 millions de dollars du gouvernement provincial; et en mai 2024, la Colombie-Britannique a adopté une loi visant à protéger les locataires de chambres individuelles des hausses de loyer marquées. Mme Pedersen continue de collaborer avec l’université, même si elle n’y occupe plus de poste officiel; elle discute avec la population étudiante et aide les chercheuses et chercheurs à établir des liens.
« J’aimerais changer le cadre relationnel universitaire : le lien entre une université et son public devrait s’axer sur la mutualité, non sur l’exploitation. »
« Ces réseaux et connaissances profitent énormément à l’université, affirme Am Johal, codirecteur de la CERi. Les activistes en résidence peuvent aider les universités à gérer les crises avec beaucoup plus d’efficacité, en temps réel. »
De plus en plus d’universités canadiennes lancent des programmes de résidence pour activistes afin d’exposer leurs étudiantes et étudiants à des réseaux, des connaissances et des projets communautaires qui améliorent la recherche. Les militantes et militants qui occupent ces postes bénéficient des ressources de l’établissement et d’une allocation, mais se sentent parfois en décalage dans un système souvent en conflit avec les causes qui leur tiennent à cœur – notamment l’embourgeoisement, la rémunération équitable et le droit de manifester. « L’université est une institution blanche, occidentale et coloniale, un agent du statu quo », soutient Marsha Hinds Myrie, qui a terminé sa résidence à l’Université de Guelph en juin. Elle défend les droits des femmes à la Barbade en plus de travailler dans le milieu universitaire.
Cette dualité pourrait, en théorie, encourager un changement dans les relations entre les établissements scolaires et les collectivités. Mais en pratique, l’argent manque. Peu des postes de résidence offerts bénéficient d’un financement stable; la plupart n’apportent aucune certitude aux activistes qui les acceptent.
Contrairement aux programmes de résidence pour les arts et la création littéraire, qui abondent depuis belle lurette, ceux réservés aux activistes sont relativement nouveaux, plutôt rares, et souvent temporaires. Ils n’ont pas vraiment été étudiés, sauf dans un document de planification publié en 2022 par le King’s College de Londres (au Royaume-Uni) à la suite d’un projet pilote déployé de 2019 à 2021.
Le document, qui présente une analyse de 15 programmes de résidence aux États-Unis et au Royaume-Uni, souligne le paradoxe : quelle place réserver aux activistes dans une institution souvent considérée comme le bastion par excellence des structures hégémoniques ainsi que le renforçateur et la source épistémique des idées mêmes que les activistes cherchent à démanteler? Il fait aussi remarquer qu’il n’existe pratiquement aucun cadre pour la création de programmes capables de transformer à la fois les établissements et les activistes.
La présence des activistes dans les universités canadiennes est loin d’avoir été constante. En 2015, l’Université Wilfrid Laurier s’est associée à Alex Tigchelaar, une artiste de la scène et ancienne travailleuse du sexe. (À l’époque, elle avait déclaré à Affaires universitaires : « Quand j’ai commencé à militer, il y a longtemps, je n’avais que du mépris pour le milieu universitaire ».) L’établissement n’a jamais renouvelé l’expérience. « Le discours sur la justice sociale a évolué depuis l’époque, et des initiatives ont été mises en place dans bien des sphères de l’université », assure Heidi Northwood, vice-rectrice principale à l’enseignement de l’Université Wilfrid Laurier.
En 2019, la Faculté de droit et des sciences juridiques a choisi comme toute première activiste en résidence Rehana Hashimi, qui avait milité pour les droits des femmes au Pakistan pendant des années, un travail qu’elle effectue aujourd’hui depuis le Canada. Son mandat : l’élaboration d’un programme à long terme. La Faculté avait fait partie du réseau Scholars At Risk, qui aide les universitaires victimes de déplacement à se trouver des postes temporaires, et souhaitait offrir un soutien semblable aux activistes.
Mais la pandémie a tout chamboulé : Mme Hashimi est restée jusqu’en 2022 – touchant à peine plus de 10 000 $ par an, plus ses revenus d’enseignement –, et personne ne l’a remplacée depuis son départ. « Avec les compressions budgétaires, c’est très difficile de trouver les fonds nécessaires », se désole la professeure agrégée Melanie Adrian, instigatrice et coresponsable du projet de résidence.
À l’Université de Guelph, les professeures Monique Deveaux et Candace Johnson, codirectrices du Laboratoire de théorie ancrée et engagée (Grounded and Engaged Theory Lab), ont recruté l’activiste immigrant Gabriel Allahdua à la fin de 2022. « Je voulais essayer un format différent pour le postdoctorat », explique Mme Deveaux, qui étudie les injustices sociales. L’année d’après, le programme est de nouveau offert; cette fois, ce sont Mme Hinds Myrie et Nneka MacGregor, directrice générale du Centre des femmes pour la justice sociale (Women’s Centre for Social Justice), qui ont partagé le rôle.
« Nous sommes des activistes. Nous ne nous censurons pas. Je ne me gêne jamais pour donner mon avis. »
Mme Deveaux indique que le programme a été financé par diverses sources, mais que son avenir pour 2025 est incertain. « Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre. Les embauches ont été gelées; ça ne présage rien de bon pour l’obtention de fonds l’année prochaine. »
Le programme de l’Université Simon Fraser est aussi en pause. La CERi, lancée en 2020, a d’abord offert un programme de résidence pour chercheuses et chercheurs, avant de se tourner vers les artistes et les activistes en 2023 pour améliorer la recherche communautaire. M. Johal cherche maintenant du financement permanent, idéalement grâce à un don qui permettrait de créer un fonds de dotation.
L’Université de la vallée du Fraser a annoncé un programme de résidence pour activistes en 2023, mais n’a offert aucune précision à Affaires universitaires quant à son statut. Par ailleurs, l’un des programmes les plus stables actuellement n’offre pas de résidence à proprement parler : le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de l’Université McGill propose un stage à une professionnelle ou un professionnel des droits de la personne, grâce à un don qui devrait permettre à deux ou trois activistes – en général, des personnes déplacées pour diverses raisons – de recevoir jusqu’à 4 000 $ par mois pour travailler sur un projet de leur choix.
Mme Adrian souligne que les activistes peuvent offrir un point de vue fondé sur une réelle expérience des enjeux. « L’administration des universités doit comprendre qu’il ne suffit pas de parler de globalisation, d’internationalisation et d’ouverture d’esprit; il faut donner aux étudiantes et étudiants des occasions concrètes de s’ouvrir au monde. »
Pour M. Johal, les activistes ont des connaissances que le corps professoral ne possède pas, particulièrement sur les groupes mal desservis. « Quand on cherche à repousser les frontières du savoir, il faut voir les choses sous un angle différent. S’exposer au monde, c’est une autre manière d’acquérir de l’expérience pour les étudiantes et étudiants. Ça les prépare à mieux faire face à la polarisation. »
Le passage de M. Allahdua à l’Université de Guelph a incité la population étudiante à militer et à faire du bénévolat. L’homme a organisé un événement réunissant activistes et universitaires, et anime toujours un groupe mensuel pour maintenir ces connexions. « Les liens qu’il nous a permis de créer ont été extrêmement profitables pour tout le monde », insiste Mme Deveaux. Il invitait souvent des travailleuses et travailleurs immigrants à l’université, et la professeure se souvient avoir discuté longuement sur un banc du campus avec une de ces personnes, qui avait été blessée. Les deux dernières activistes en résidence ont pour leur part organisé des événements et renseigné la communauté universitaire sur le militantisme sexospécifique.
Toutefois, ces programmes nécessitent une gestion constante, souvent assurée par des membres du corps professoral et du personnel des petites facultés. Le rapport du Royaume-Uni les qualifie de « laborieux », une opinion que partage Nandini Ramanujam, professeure et codirectrice du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de l’Université McGill. « Il ne s’agit pas d’une simple entente transactionnelle. C’est un programme qui requiert énormément d’administration. » Sa petite équipe aide les stagiaires à se loger et à obtenir des soins de santé mentale – les activistes sont souvent victimes de menaces, de traumatismes et de déplacement. « Il faut avoir l’amour du travail. »
S’occuper du programme implique aussi de prendre la parole lors des réunions budgétaires et de solliciter des dons. Les programmes de résidence en arts peuvent compter sur l’aide des conseils des arts, et le King’s College de Londres bénéficie d’une subvention nationale pour les projets transformateurs, mais il n’existe aucun financement de ce type pour l’activisme au Canada.
Les activistes en résidence ne se voient offrir que peu d’argent : Mme Hinds Myrie, par exemple, reçoit 3 000 $ par mois de l’Université de Guelph. Son loyer lui en coûte 2 500. Mme MacGregor, quant à elle, a remis son allocation à son centre, et Mme Pedersen en a fait don à une famille dans le besoin de sa région.
Le programme offre toutefois un avantage non négligeable pour les activistes victimes de déplacement : un peu de stabilité. « À mon arrivée, je n’arrivais pas à trouver de travail ni à obtenir de reconnaissance », raconte Mme Hashimi. À son avis, le Canada devrait investir dans ces programmes, afin d’offrir aux gens comme elle une certaine reconnaissance.
L’université peut aussi donner accès à différents systèmes, collectivités et compétences, et ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi.
Les programmes de résidence n’aident cependant pas toujours les activistes à faire avancer leur carrière et leur cause. « Pour moi, rien n’a changé, affirme Mme Hinds Myrie. J’ai accès gratuitement à la bibliothèque de l’université, et c’est très pratique, mais ma collectivité n’en profite pas. » Elle indique qu’on ne lui a pas accordé d’entrevue pour un emploi de professeure adjointe en études critiques de la race, bien qu’elle enseigne déjà des cours dans le programme, qu’elle détienne un doctorat en sciences politiques et qu’elle ait effectué son stage postdoctoral à l’Université de Guelph. « Ma candidature n’était pas assez intéressante pour un poste de professeure adjointe… Seulement pour le rôle précaire d’activiste en résidence. » Depuis, elle a été embauchée par l’université comme conceptrice de pédagogie anti-oppressive et inclusive.
On n’accueille pas toujours les activistes à bras ouverts sur les campus. « Bien des gens avaient hâte de travailler avec [M. Allahdua], se rappelle Mme Deveaux. Mais l’école d’agriculture s’est montrée particulièrement réticente : l’exploitation des travailleuses et travailleurs immigrants dans le secteur reste un sujet délicat. » Mme Hashimi reconnaît que les activistes ne mâchent pas leurs mots. « Nous sommes des activistes. Nous ne nous censurons pas. Je ne me gêne jamais pour donner mon avis. »
Ces programmes de résidence pourraient être extrêmement bénéfiques pour les deux parties, pour peu qu’on leur accorde davantage d’attention. « C’est un moyen pour l’Université Simon Fraser de se rapprocher de la collectivité, de lui ouvrir ses portes. Tout passe par les relations », soutient Mme Pedersen. Mme Hinds Myrie estime que les activistes pourraient aider les universités à adopter un modèle plus équitable. « J’aimerais changer le cadre relationnel universitaire : le lien entre une université et son public devrait s’axer sur la mutualité, non sur l’exploitation. »
Avec un peu plus d’argent et beaucoup plus de soutien, ces programmes pourraient devenir des moteurs de changement social, tant dans le milieu universitaire que dans la collectivité. Mme Hashimi conclut : « Les activistes sont une source extrêmement avantageuse de connaissances, de compétences et d’expérience ».



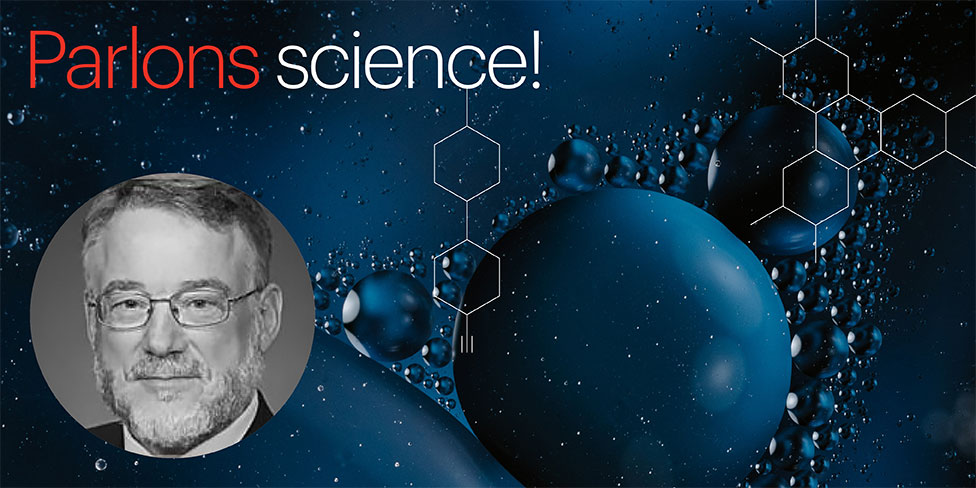








Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.