Être noir.e et étudier aux cycles supérieurs : un parcours empreint de joies et de peines
Créée par une chercheuse, la série de webinaires The Good and the Bad of Black Grad fait résonner la voix des universitaires noir.e.s de tout le pays.

Terreur nocturne
Quelque chose cloche. Je fouille la noirceur pour comprendre où je suis. Haletante, je me mets à réfléchir :
Zut! Est-ce que je suis en retard? Est-ce que j’ai mis assez de solvant sur l’instrument? Est-ce que j’ai répondu à ce courriel désagréable? Qu’est-ce que j’ai oublié? Mon réveille-matin n’a pas sonné! Mais quelle heure est-il?
Je jette un œil à mon téléphone : 4 h 37. Au bout de quelques secondes, je comprends que je suis dans mon lit, dans ma chambre – dans mon appartement, à Kamloops.
Respire. Inspire par le nez : un, deux, trois… Expire par la bouche : un, deux, trois…
Encore.
Encore.
Encore, jusqu’à ce que les battements de mon cœur s’apaisent et que mon esprit se calme. Jusqu’à ce que mes mains cessent de trembler et que je puisse me dire :
Tu es en sécurité. Tout va bien. C’est fini. Il n’a plus aucun pouvoir sur toi.
Il y a un an, je quittais Edmonton – pour le mieux – après avoir obtenu mon doctorat à l’Université de l’Alberta. Aujourd’hui, je prends des médicaments qui ont beaucoup amélioré ma qualité de vie. Mon état est stable. Mais de temps à autre, les traumatismes refont surface. Mes déclencheurs ne sont jamais loin et l’inquiétude ne me quitte jamais. Mais j’arrive à sourire la plupart du temps.
Il y a une dizaine d’années, j’étais une étudiante naïve de 23 ans, prête à sauter dans le train des études supérieures. Emportant beaucoup trop de valises, je quittais Brampton, en Ontario, pour Edmonton avec un enthousiasme débordant. Je me souviens que le jour de mon départ, j’avais des papillons dans le ventre. J’étais pleine de curiosité – j’entrevoyais mon parcours avec beaucoup de candeur.
Je savais que ce n’était pas gagné d’avance. Je m’étais inscrite pour me mettre au défi et pour me dépasser dans mes études. Mais rien ne m’avait préparée à presque sept années de honte, d’humiliation et de tourment : mon programme de doctorat allait me faire souffrir de grave anxiété et de dépression. Il n’est pas rare chez les étudiant.e.s aux cycles supérieurs de souffrir de troubles de santé mentale. Les raisons peuvent être multiples, allant d’une situation au seuil de la pauvreté à une dynamique de pouvoir tordue entre étudiant.e et directeur ou directrice de recherche. Tous ces facteurs néfastes pour la population étudiante n’ont jamais été aussi présents dans les universités du monde. Comme étudiante canadienne n’ayant pas à se soucier de ses droits de scolarité, j’ai été relativement privilégiée. Mais faisant partie des rares personnes noir.e.s aux cycles supérieurs, j’ai été confrontée à l’isolement qui accompagne ce statut, une solitude à laquelle beaucoup ne survivent pas.
Éveil
Ce n’est qu’à la fin de mon doctorat que j’ai commencé à créer un réseau personnel d’étudiant.e.s noir.e.s. Le mouvement Black Lives Matter avait éveillé un sentiment de fureur des deux côtés de la frontière canado-américaine, et relancé ici les discussions sur la race. Derrière le voile de siècles de déshumanisation et d’assujettissement, il y a toujours eu des tensions. Avant que le pays ne se positionne comme un champion du multiculturalisme, le racisme était plus apparent : il y a des liens évidents avec l’histoire colonisatrice du Canada. (Pour citer un exemple, il y a 100 ans de cela, le premier ministre Wilfrid Laurier tentait d’interdire par les voies officielles l’immigration noire au pays parce que la race noire était « considérée comme inadaptée au climat et aux exigences du Canada ».) L’ire collective suscitée par #BlackLivesMatter a donné lieu au mouvement #BlackInTheIvory, qui met en lumière la présence du racisme dans différentes institutions, dont les universités. À l’Université de l’Alberta, les étudiant.e.s noir.e.s ont fait front commun pour signer une pétition demandant à la direction de donner suite à leurs appels à l’action. Le meurtre fatidique de George Floyd a libéré une angoisse que j’avais étouffée toute ma vie. En même temps, d’une manière aussi inattendue qu’inaltérable, ce fut aussi une source de réconfort pour moi, parce que j’avais pris conscience de ma colère et que j’avais trouvé une communauté.
À ce moment, l’association des étudiant.e.s noir.e.s aux cycles supérieurs (BGSA) de l’Université existait depuis moins d’un an et militait comme jamais. Je m’y suis jointe et j’ai canalisé ma rage en écrivant, en organisant des actions et en réclamant que les choses changent. Depuis quelque temps, une idée faisait son chemin dans le chaos de mes pensées. J’ai réuni des ami.e.s de la BGSA et des collègues du tout nouveau Réseau canadien des scientifiques noir.e.s. Même en ligne, le lien était fort. Nous avons échangé des blagues et des histoires. Il y avait un sentiment de familiarité, pas très différent d’un moment entre cousin.e.s au barbecue familial pendant que les adultes rattrapent le temps perdu. J’ai demandé si une série de balados sur le parcours universitaire d’une personne noire au Canada semblait utile. Une discussion animée a révélé des similitudes frappantes (parfois bouleversantes) entre nos expériences. En a résulté une longue liste de sujets possibles. Ce jour-là, de nombreuses personnes ont proposé de participer à ce projet en devenir.
Au Canada, on avait éhontément évité toute discussion sur le racisme anti-Noir.e. Les nombreuses crises de 2020 ont placé le monde devant un tournant. Jusque-là, l’absence de données raciales avait conforté l’aveuglement volontaire des universités et cimenté les torts faits aux étudiant.e.s et universitaires noir.e.s par leurs collègues et homologues. Les plaintes de personnes racisées ont été réduites à des cas anecdotiques, renforçant par le fait même le racisme dans toutes les sphères, et maintenant le statu quo. Je voulais créer une plateforme qui ferait entendre les voix des universitaires noir.e.s de partout au pays. À ce stade de la pandémie, le webinaire était devenu courant. J’imaginais une conversation informelle dans un cadre intime où les invité.e.s auraient envie de raconter leur histoire. Le public écouterait de vraies discussions, sans artifice, dans un espace qui n’avait jamais existé auparavant. On allait pouvoir apprendre beaucoup. Je suis heureuse de ne pas avoir été la seule à trouver l’idée bonne.
Montée
Quand j’ai su que l’Association canadienne pour les études supérieures (ACES) pourrait possiblement financer le projet, j’ai sauté sur l’occasion – en fait, je me suis volontairement lancée dans l’inconnu. Après avoir pris connaissance de ma proposition, l’ACES a accepté de parrainer ma série. « The Good and the Bad of Black Grad » était née. Réalisée de mars à octobre 2021, la série de cinq webinaires venait concrétiser ma vision. J’ai eu le privilège et la responsabilité de décider de chaque aspect du projet : communiquer avec les invité.e.s, embaucher des designers graphiques, recruter des commanditaires pour les épisodes, réaliser le montage des épisodes après la diffusion. Ce projet était mon bébé. Je savais à quel point c’était important pour la communauté universitaire noire : je n’allais pas laisser tomber.
Je restais debout jusqu’aux petites heures à réviser mes courriels aux invité.e.s et à confirmer leur disponibilité. Comme animatrice, je devais songer à des questions qui seraient à la fois assez provocantes pour attirer l’attention de l’auditoire et assez accessibles pour que les invité.e.s se sentent à l’aise. J’ai embauché autant que possible des personnes noires; je ne serais arrivée à rien sans Rahwa Asrat et Belen Gelata, deux étudiantes de l’Université de Calgary qui ont formé mon infaillible et fidèle équipe de communications. Chaque épisode exigeait de régler une multitude de détails dont je n’avais eu jusque-là aucune conscience. L’un de ceux-ci était plutôt agréable : il fallait trouver des titres accrocheurs, une grande responsabilité. J’aimais bien user du procédé allitératif (« Recruit, Retain and Represent! », « Black Don’t Crack? The Blessings and Blues of Black Mental Health »).
Le premier épisode exigeait un titre un peu plus sérieux, car « Being the Only One » n’a rien de drôle. Ce titre émanait d’une lettre que j’avais écrite un an auparavant, et qui allait devenir un texte d’opinion dans Maclean’s. Tout au long de la série, j’ai tenté de faire participer des invité.e.s de divers domaines et lieux géographiques. Le premier épisode comportait trois segments distincts – le bon, le mauvais, et l’avenir –, ainsi que des questions connexes pour alimenter la discussion. Kayonne Christy (ancienne étudiante de l’Université de la Colombie-Britannique, maintenant à l’Université du Michigan), Melanie Morrison (ancienne étudiante de l’Université de Toronto, maintenant à l’Université de Californie à San Francisco) et Tiffany Gordon (étudiante à l’Université Dalhousie) s’exprimaient avec beaucoup d’éloquence, ce qui a facilité l’animation. Quand Carl James, professeur d’éducation à l’Université York, a accepté mon invitation, j’étais euphorique. Il a fait prendre un tour nouveau à la conversation, posant des questions sur nos réflexions en cette période d’évolution. C’est lui qui m’a inspirée à ajouter le quatrième segment, « Petition a Prof » pendant lequel une chercheuse ou un chercheur d’expérience viendrait donner son avis sur le sujet du jour.
La discussion a naturellement glissé d’un sujet à un autre. Les 90 minutes ont filé doucement; nous aurions pu continuer encore longtemps. J’allais rapidement éliminer ma structure initiale qui s’appuyait sur plusieurs segments et entravait la progression naturelle des discussions. Et puis, une expérience de vie peut difficilement entrer dans des cases définies. Beaucoup ont comparé les études supérieures à des « montagnes russes » : un parcours tumultueux entre joies inattendues et peines à crever le cœur, ponctué de moments de bonheur, de souffrance et de confusion. Même si le titre suggérait une dichotomie entre l’expérience des étudiant.e.s noir.e.s aux cycles supérieurs et celle des autres, la série a montré qu’il y avait autant de perspectives que de personnes parce que nous ne formons évidemment pas un bloc monolithique. Je pense que la série a bien montré cette réalité.
Rêverie
Comme réalisatrice, animatrice et productrice, je n’étais qu’une débutante; si J,en avais l’occasion, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment. J’aurais aimé embaucher une éditrice ou un éditeur vidéo pour tout le projet, un.e étudiant.e qui aurait intégré l’équipe de communication et créé quelques vidéoclips amusants qu’on aurait pu utiliser de toutes sortes de manières. J’aurais aimé produire au moins un épisode où il y aurait eu des invité.e.s et un animateur ou une animatrice francophones. Il aurait été vraiment intéressant d’entendre des universitaires du Québec et de l’Est, qui auraient sans doute amené des points de vue qui n’ont pas été abordés. La série n’était pas entièrement accessible. J’aurais adoré qu’il y ait un.e interprète en langue des signes, et qu’au moins tous les épisodes soient sous-titrés en anglais et en français. D’autres petits détails auraient pu venir parfaire le tout.
On venait tout juste de franchir un cap historique qui avait rendu cette série possible. Pour l’heure, ces discussions semblent avoir été entendues et voulues par les établissements postsecondaires. Il y a encore beaucoup de discussions à tenir, mais les plus importantes sont sans doute celles qui en découleront. Tout ce que je peux espérer, c’est qu’un jour, une personne verra ne serait-ce qu’un bout d’un épisode et apprendra quelque chose.
Lucidité
Les notes de « Kill Bill » de SZA enflent.
Encore cinq minutes. Je reprogramme la sonnerie.
Ces jours-ci, je développe avec une petite équipe une stratégie de données sur la diversité. Mes travaux postdoctoraux visent à comprendre comment les gens vivent (ou ne vivent pas) l’équité sur les campus. Je me lève pour les étudiant.e.s : je n’ai jamais rencontré ces personnes, mais je sais qu’elles méritent d’accéder à l’éducation ou au moins d’avoir le choix. J’espère que mon travail contribuera positivement aux expériences postsecondaires des apprenant.e.s des groupes historiquement marginalisés.
Peut-être ne suis-je pas si altruiste et que je fais tout cela pour moi-même – ou plutôt pour venger la jeune fille que j’étais. Peut-être fais-je tout cela dans l’espoir de réparer des années de torts causés durant mes études supérieures. La série m’a permis de faire le point sur mes propres expériences de façons jusqu’alors insoupçonnées. Deux ans plus tard, je suis beaucoup plus heureuse.
L’alarme sonne une deuxième fois. Je sors du lit. Je m’habille, me brosse les dents. J’ouvre l’eau pour avaler mon cachet. Direction la salle d’entraînement, puis le travail. Il faut que je bouge tous les jours pour éloigner les idées noires.
« The Good and the Bad of Black Grad » a été financé en partie par l’Association canadienne pour les études supérieures. Tous les épisodes sont accessibles sur YouTube.





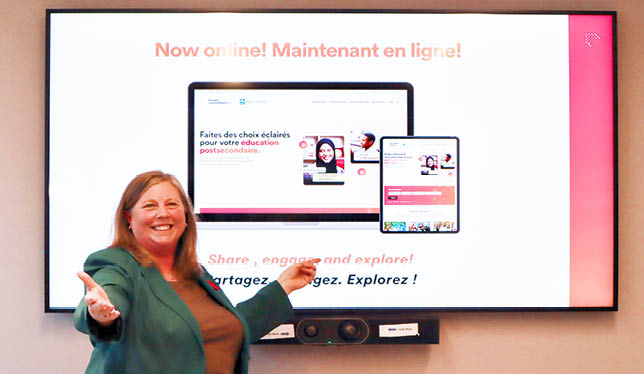






Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.