Le Canada, second violon dans la recherche sur le VIH
Bien que le VIH passe plus que jamais sous le radar, la recherche pour le mettre en échec suit son cours au Canada, mais surtout ailleurs.

Dans l’histoire à succès qu’est la lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la hausse récente de nouvelles infections fait désordre. Le Canada a par exemple enregistré une augmentation de près de 25 % des diagnostics en 2022 par rapport à 2021, rapportait en février la Fondation canadienne de recherche sur le sida. Il s’agit d’une première depuis plus d’une décennie.
Un phénomène semblable s’observe notamment dans l’Union européenne, où la progression est de plus de 30 % pour la même période. Dans un cas comme dans l’autre, on parle de milliers de personnes positives au virus responsable du sida… lorsqu’elles sont testées. Car environ 1 personne porteuse du VIH sur dix au Canada ne serait pas consciente de son statut.
La réduction des services de dépistage fait partie des hypothèses avancées pour expliquer ce recul. La faute à la COVID-19 qui a relégué l’autre pandémie au second plan, mais aussi au manque d’éducation sexuelle chez les jeunes générations. Ce sont d’ailleurs les Canadiens et Canadiennes âgés de 30 à 39 ans qui sont les plus représentés parmi les nouveaux cas déclarés.
« Pour tout un pan de la population, le VIH est un virus comme les autres, constate Nicolas Chomont, professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal et spécialiste du VIH. Cette banalisation s’accompagne d’une baisse de la prévention. »
L’absence de grandes campagnes de santé publique sur le VIH contribue en outre à renforcer ces perceptions. « L’époque où les personnes séropositives mourraient en masse est depuis longtemps révolue. Ces dernières survivent désormais à la maladie, et ce, sans la transmettre », relève Sean Hosein, rédacteur scientifique et médical pour CATIE, la source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C.
Le point tournant a été l’avènement, en 1996, des premiers médicaments antirétroviraux utilisés en association les uns avec les autres. La trithérapie, soit la combinaison de trois molécules à la fois, a ainsi permis de contrôler l’infection et de rendre aux malades une espérance de vie quasi normale.
Les traitements actuellement disponibles sur le marché sont d’une redoutable efficacité. Plus besoin d’ouvrir chaque jour son pilulier ; les patients bénéficient désormais de médicaments injectables qui agissent pendant deux mois. Une injection une fois de temps à autre, et c’est tout.
« L’observance thérapeutique est un réel enjeu chez les personnes vivant avec le VIH. Plusieurs éprouvent une réelle difficulté à avaler des comprimés au quotidien », fait valoir M. Hosein. La prophylaxie préexposition, ou PrEP, qui consiste à prendre un médicament afin d’éviter de se contaminer au VIH, connaît les mêmes avancées.
N’empêche, ces traitements antirétroviraux doivent être pris pour toute la vie – il suffit de quelques semaines d’arrêt pour que le virus se multiplie à nouveau, ce qu’on appelle un rebond viral.
« Même si leur virémie est contrôlée, les patients touchés par le VIH qui se soignent depuis longtemps sont aux prises avec des comorbidités, comme un plus grand risque de développer des maladies cardiovasculaires », explique Éric Cohen, directeur de l’unité de rétrovirologie humaine à l’Institut de recherches cliniques de Montréal, qui étudie le VIH depuis le début de sa carrière, il y a plus de 30 ans.
Tout cela représente un fardeau considérable. En 2011, la Société canadienne du sida estimait que la valeur nette de la perte économique attribuée aux personnes infectées par le VIH était de 1,3 million de dollars (M$) par individu. Ce montant, qui englobe entre autres la perte de productivité et la baisse de la qualité de vie, totaliserait aujourd’hui plus de 1,7 M$ avec simple ajustement à l’inflation.

Un ennemi insaisissable
Dans ce contexte, la guérison d’une infection au VIH représente encore et toujours le Graal. Mais, comme dans la légende arthurienne des chevaliers de la Table ronde, la quête est parsemée de multiples péripéties. En cause : un virus notoirement difficile à bouter hors de l’organisme, où il joue à la cachette.
« Les trithérapies diminuent la charge virale de 99,99 %, illustre M. Chomont. Le 0,01 % restant se répartit dans plusieurs tissus profonds de la rate et des ganglions, mais aussi du cerveau. » Ce sont les fameuses cellules réservoirs, où l’infection demeure en latence tant que le patient suit son traitement.
Dans son laboratoire, le chercheur s’évertue à caractériser ces adresses clandestines dans lesquelles le VIH se planque. Avec son équipe, il a par exemple démontré que les cellules infectées ont le potentiel de se déplacer dans d’autres organes, ce qui rend la chirurgie inopérante. Cette étude réalisée à partir d’échantillons de tissus de donneurs canadiens et donneuses canadiennes atteints du VIH a été publiée dans la revue savante Cell Reports en 2023.
Si de tels travaux ont pour objectif d’éliminer les réservoirs viraux, force est d’admettre que leurs résultats sont pour l’instant mitigés. Une des nouvelles approches thérapeutiques mises au point dans les dernières années, qui exige si l’on veut de « réveiller » les réservoirs cellulaires pour mieux les attaquer et les supprimer, a ainsi produit des résultats plutôt décevants, de l’avis de l’expert.
« Les études d’éradication du VIH permettent au mieux une petite réduction des réservoirs qui est de peu d’intérêt du point de vue clinique. Que vous ayez 100 000 de ces cellules plutôt qu’un million ne change rien au problème fondamental », analyse M. Chomont. Dans un monde idéal, il n’en faudrait plus du tout.
Les stratégies de guérison du VIH s’appuieront donc vraisemblablement sur une combinaison d’approches plutôt qu’une seule. À la suppression des réservoirs pourrait par exemple se superposer des thérapies pour stimuler le système immunitaire. Après tout, ce dernier constitue la principale cible de l’infection au VIH non prise en charge, qui l’affaiblit peu à peu.
De manière surprenante, la recherche récente sur le VIH s’inspire beaucoup de celle sur le cancer. Cela est dû au mode de fonctionnement analogue de ces maladies, où des groupes de cellules indésirables prolifèrent à des vitesses plus ou moins élevées dans les deux cas.
Des traitements contre le cancer comme l’immunothérapie font en ce sens l’objet de nombreuses recherches. Les anticorps monoclonaux utilisés dans certaines de ces thérapies biologiques viennent en effet aider les défenses immunitaires du patient à éliminer son propre cancer. De là à dire que ces molécules synthétiques ont le potentiel d’agir de la même manière chez les personnes vivant avec le VIH, il n’y a qu’un pas.
Une autre piste explorée est celle des vaccins à ARN messager, ceux-là mêmes qui ont été développés lors de la pandémie de COVID-19. La société de biotechnologies américaine Moderna a d’ailleurs lancé en 2021 un essai clinique pour mettre à l’épreuve cette technologie contre le VIH – la phase 1 est toujours en cours.
« La crise sanitaire nous a permis de faire des pas de géants dans notre compréhension de ces vaccins, notamment sur la structure et le rôle complexe des anticorps, admet M. Cohen. Cela dit, contrairement au VIH, la COVID-19 est une infection aigüe dont on peut guérir de manière spontanée. »
Car, il n’existe pas de cas répertoriés de personnes séropositives qui ont vaincu par elles-mêmes le VIH. Les seules guérisons connues de la maladie concernent une poignée d’individus, soit les patients de Berlin, de Londres et de Düsseldorf. Ces derniers s’en sont débarrassés à la faveur de greffes de moelle osseuse provenant d’un donneur porteur d’une rare mutation génétique qui confère à ses porteurs une résistance à l’infection.
Seul problème : le taux élevé de mortalité consécutive à cette opération de l’ordre de 20 à 30 %, ce qui en fait une option de dernier recours – les trois cas documentés de guérison souffraient tous d’ailleurs d’une leucémie résistante aux traitements conventionnels au moment de leur transplantation miraculeuse.
C’est notamment ce qui explique pourquoi la recherche sur le VIH progresse à pas de tortue ; la prise de risque paraît ipso facto démesurée par rapport au traitement antirétroviral de l’infection qui, pour rappel, est assez bien toléré. « Nous sommes un peu victimes de nos succès passés », convient M. Cohen, qui entrevoit néanmoins des percées significatives dans les prochaines années.
« Nous allons voir émerger des interventions aux impacts graduels, dans une logique de rémission de la maladie, prévoit-il. La guérison ne se fera pas de manière soudaine, mais bien au bout de plusieurs années de suivi de la charge virale à la suite d’un arrêt définitif des traitements, lorsque le patient se sera bel et bien stabilisé. »
L’étoile pâlissante du Canada
Si le passé est garant de l’avenir, ces avancées scientifiques demanderont des investissements importants. À ce chapitre, le Canada fait figure de parent pauvre, surtout si on le compare à des pays comme les États-Unis qui consacrent bon an mal an plus de 3 milliards de dollars américains à la recherche sur le VIH.
M. Cohen est bien placé pour témoigner de cette réalité ; il dirige le Consortium canadien de recherche sur la guérison du VIH (CanCURE), une équipe de recherche pancanadienne qui étudie la persistance du VIH et le développement de stratégies thérapeutiques. Dans les dernières années, il a vu fondre le financement accordé par les Instituts de recherche en santé du Canada.
« Au départ, en 2014, CanCURE était financé à hauteur de 1,8 M$ par année. Puis, en 2019, ce montant est passé à 1,2 M$, raconte le principal intéressé. Le nouveau concours [de septembre 2024] nous permet d’aller chercher un maximum annuel de 750 000 $. » Pendant ce temps, il estime que des équipes américaines de taille comparable jouissent d’un financement « cinq fois plus élevé » pour travailler sur les mêmes questions.
Cela n’a toutefois pas toujours été le cas. Dès le début de l’épidémie dans les années 1980, des chercheurs et chercheuses de Montréal mettent par exemple au point l’un des premiers traitements efficaces contre le VIH : le 3TC, aussi appelé lamivudine. Ce médicament antirétroviral, ensuite homologué au milieu des années 90, demeure aujourd’hui l’une des pierres angulaires des trithérapies.
C’est aussi à cette époque faste que sont lancées des initiatives comme le Réseau SIDA-Maladies infectieuse. Pendant vingt-cinq ans, ce regroupement de chercheurs et chercheuses du Québec a constitué une importante banque d’échantillons biologiques de gens ayant notamment le VIH, ce qui a permis la réalisation de nombreux projets de recherche. Le Réseau a récemment perdu son financement de la part des Fonds de recherche du Québec.
Les chercheurs canadiens et chercheuses canadiennes parviennent malgré tout à apporter leur pierre à l’édifice. « Nous nous focalisons sur des aspects moins couverts de la recherche, sur ses angles morts. Au lieu de courir après les “low-hanging fruits”, nous faisons preuve d’originalité », explique M. Cohen. Plusieurs, comme M. Chomont, comptent sur les Instituts nationaux de la santé des États-Unis pour financer leurs travaux sur le VIH.
Le récent réinvestissement du gouvernement du Canada en recherche et en innovation suscite néanmoins de l’espoir. Même si aucune somme n’est spécifiquement dédiée à la recherche sur le VIH dans le budget fédéral 2024, la bonification des bourses d’études à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat pourrait faciliter le recrutement d’étudiants et étudiantes dans les laboratoires de recherche sur le VIH.
Sera-ce suffisant pour susciter de nouvelles vocations ? « Vous savez, répond M. Cohen, le VIH est relégué au second rang par rapport à d’autres domaines de recherche comme l’intelligence artificielle ou les neurosciences. Cela devient forcément plus difficile de convaincre de jeunes chercheurs de travailler sur ce sujet de nos jours par rapport à 30 ans auparavant. » Là aussi, les succès du passé sont difficiles à rééditer.
Quelques statistiques
1981 : Année de diffusion de la première alerte de ce qui sera plus tard considéré comme la plus grande catastrophe sanitaire de tous les temps par l’Organisation mondiale de la santé.
39 millions : Nombre de personnes dans le monde qui vivaient avec le VIH en 2022. (Source : ONUSIDA)
62 790 : Nombre de Canadiens et Canadiennes qui vivaient avec le VIH à la fin de 2020. (Source : Agence de la santé publique du Canada)
6472 : Nombre de personnes autochtones qui vivaient avec le VIH au Canada en 2020, soit 10,3 % de l’ensemble des Canadiennes et Canadiens séropositifs. À peine 5 % de la population du pays s’identifie pourtant comme autochtone. (Sources : Agence de la santé publique du Canada et Statistique Canada)
19 cas par 100 000 habitants : Taux de diagnostics de VIH en Saskatchewan en 2022, ce qui place la province bien au-dessus de la moyenne nationale de 4,7 cas par 100 000 habitants. (Source : Fondation canadienne de recherche sur le sida)





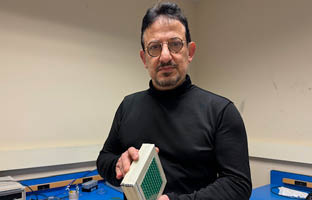






Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.