Enseigner à l’ère du désespoir
Le personnel enseignant peut offrir aux étudiantes et étudiants l’empathie, les renseignements et les compétences nécessaires pour traverser cette époque trouble.

Une personne étudiante au premier cycle m’a récemment confié son désespoir face au contexte actuel : « Le monde va de mal en pis, et ce n’est pas près de s’arrêter. » Ce ne sont en effet pas les sujets de préoccupation qui manquent pour les jeunes d’aujourd’hui. Que leur réserve l’avenir? Qu’adviendra-t-il de la démocratie, des droits de la personne, des relations internationales? Les questions se multiplient, mais restent sans réponse. Pour nombre d’étudiantes et étudiantes dans bien des domaines, l’époque est au désespoir.
Comment, dans ce contexte, les universités peuvent-elles faire renaître l’espoir?
Je tenterai de répondre à la question avec Christie Schultz, doyenne du Centre de formation continue et à l’Université de Regina et spécialiste du leadership axé sur le soin dans l’enseignement supérieur. Ensemble, nous verrons comment le corps enseignant peut aider les étudiantes et étudiants grâce à une approche empathique et relationnelle. Ce texte s’inscrit dans la lignée de nos articles sur le travail émotionnel dans le milieu universitaire (Valoriser le travail émotionnel dans le milieu universitaire, Les compétences relatives au soin : gérer sa charge de travail émotionnel dans le milieu universitaire et Diriger avec soin : travail émotionnel et leadership universitaire), que nous vous invitons à (re)lire.
Faire preuve d’empathie envers ses étudiantes et étudiants
Nous vous encourageons à adopter une approche empathique, par exemple en faisant des liens avec vos propres expériences. La cohorte actuelle n’est pas la seule à devoir traverser une période difficile : la COVID, la récession de 2008-2009 et le 11 septembre ont aussi généré bien du stress et de l’anxiété chez les étudiantes et étudiants de l’époque. Si vous avez vécu de tels bouleversements durant vos études, vous vous souviendrez certainement du climat général d’incertitude.
La situation actuelle a toutefois ses particularités. On retrouve de plus en plus de profils « non traditionnels » dans les salles de classe : parents monoparentaux, professionnelles et professionnels à temps plein, personnes neurodivergentes et gens de tous les horizons sociodémographiques. Comme l’écrit Debora L. VanNijnatten, « Je ne crois pas que nous ayons réellement saisi toute la complexité de ces êtres humains que sont nos étudiantes et étudiants. Il faudra du temps et des ressources pour trouver des moyens d’établir la connexion. » De plus, comme il a déjà été mentionné dans cette article, une bonne partie de la population étudiante d’aujourd’hui a grandi à l’ère des médias sociaux, dans une époque de pandémie, de confinement et de stress mental croissant. Et pour ne rien arranger, l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) soulève tout un lot d’enjeux, notamment en ce qui concerne l’intégrité académique.
Autrement dit, vos étudiantes et étudiants ont des inquiétudes qui leur sont propres et qui pourraient vous échapper. Voici quelques sujets susceptibles de les préoccuper :
- Comment réussir à payer mes frais de scolarité, ma nourriture et mon loyer? Entre les hausses du panier d’épicerie, du logement et des frais de scolarité, beaucoup d’étudiantes et d’étudiants peinent à assumer leurs frais de subsistance et souffrent parfois d’insécurité alimentaire. Alors que les tarifs douaniers des États-Unis risquent de plomber l’économie canadienne, la question se pose : la précarité financière nuira-t-elle à leurs études?
- Comment utiliser l’IA générative sans compromettre l’intégrité académique? La question de l’IA générative est extrêmement complexe, pour la population étudiante comme pour le personnel enseignant. Les outils de détection de l’IA sont loin d’être infaillibles, et chaque cours a ses propres règles concernant son utilisation. De plus, les sanctions pour inconduite universitaire peuvent avoir de graves conséquences, particulièrement pour les personnes vulnérables : comme l’indique Shannon Dea, « Au Canada, un vol de moins de 5 000 $ ne mène pas à une déportation, mais une inconduite universitaire liée à un travail qui vaut 10 % de la note finale pourrait entraîner la perte d’un permis d’études ».
- À quoi ressembleront le marché du travail et le coût de la vie lorsque j’aurai mon diplôme? Les étudiantes et étudiants d’aujourd’hui accordent beaucoup d’importance à leurs perspectives d’emploi. D’après Mme VanNijnatten, « la population étudiante a une vision nettement utilitariste de l’éducation. Des années de données recueillies par le Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires montrent que les inscriptions à l’université sont d’abord motivées par le désir d’obtenir un emploi et d’améliorer son statut. L’expérience d’apprentissage est indéniablement reléguée au second plan. » Avec les répercussions potentielles des tarifs douaniers, de l’automatisation et de l’IA sur l’économie et le marché de l’emploi et l’augmentation constante du coût de la vie, il y a en effet de quoi s’inquiéter. Un sondage réalisé en 2024 par la firme Environics révèle que la population canadienne est de plus en plus pessimiste quant aux perspectives de mobilité intergénérationnelle; les 18-29 ans, en particulier, se considèrent moins riches que leurs parents au même âge.
- À quoi ressemblera la société de demain? Face à la montée de la polarisation politique, du scepticisme à l’égard de la science et de l’anti-intellectualisme, les étudiantes et étudiants pourraient craindre l’émergence d’une société qui ne reflète pas leurs valeurs. Chez les chercheuses et chercheurs, particulièrement aux cycles supérieurs, on craint une https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2025/02/07/nx-s1-5289912/unprecedented-white-house-moves-to-control-science-funding-worry-researchersdiminution du financement et l’imposition de restrictions sur les sujets de recherche, comme aux États-Unis.
La population étudiante n’est évidemment pas la seule à sombrer dans la morosité; la situation touche également le corps professoral canadien. Les personnes qui occupent un poste menant à la permanence redoutent que les pressions financières croissantes sur les universités n’affectent leur charge de travail et la qualité de celui-ci, et celles qui occupent un poste temporaire craignent de perdre leur emploi.
Comment remettre les choses en perspective?
Le contexte actuel préoccupe à la fois la population étudiante et le corps enseignant. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau. Mais les membres du corps enseignant ont l’occasion et même, à notre humble avis, la responsabilité d’aider leurs étudiantes et étudiants en leur offrant de l’empathie, des renseignements et des moyens de perfectionner leurs compétences.
On vous l’a probablement déjà dit : il y a certaines choses qu’on peut contrôler, et d’autres non. Ne l’oubliez pas. Vous pouvez contrôler votre éthique de travail, vos comportements et votre façon de communiquer, par exemple. Vous ne pouvez pas contrôler le passé, les actions des autres, la météo ou la politique internationale. L’auteure Shawna Lemay nous invite également à prendre conscience de nos « trois mètres d’influence » – une zone qui, si elle paraît bien petite, peut changer bien des choses au quotidien, peut-être encore plus durant les périodes difficiles.
Nous vous suggérons donc d’offrir le conseil suivant à vos étudiantes et étudiants : pensez à ce qui est sous votre contrôle, à ce qui ne l’est pas, et finalement à ce que vous pouvez influencer. C’est dans cet espace liminal, entre le contrôle et l’absence de contrôle, qu’on peut expérimenter, espérer, changer les choses, s’amuser, s’émerveiller, imaginer… et travailler à bâtir un avenir meilleur. (Dans le même ordre d’idées, la récente entrevue de Mattea Roach avec Imani Perry souligne « l’extraordinaire capacité qu’ont les êtres humains à trouver la beauté au cœur de la laideur ».) C’est un bon moyen de conserver un certain sentiment de contrôle sur son existence en ces temps troublés.
Cette approche du soutien axée sur l’empathie et l’expérience a un autre avantage : elle nous rappelle que nous avons nous aussi fait face à l’adversité, surmonté les obstacles et survécu, et que nous avons malgré tout la capacité de nous épanouir.
Comment redonner espoir aux étudiantes et étudiants
Pour que les étudiantes et étudiants se sentent vus, écoutés et compris, il faut leur manifester de l’empathie et les encourager à remettre les choses en perspective. En les aidant à faire des liens entre leurs études et le monde réel, vous atténuerez leur sentiment d’impuissance et les aiderez à reprendre confiance en l’avenir. Voici quelques suggestions pour ce faire :
- Demandez-leur en quoi le contexte actuel influe sur leurs vies, leur avenir et leur domaine d’études. (Vous pourriez vous inspirer des stratégies présentées dans l’article d’Affaires universitaires intitulé Aborder le conflit Israël-Hamas en salle de classe, publié en 2024; nombre d’entre elles s’appliquent à toutes sortes d’autres sujets litigieux.)
- Animez des discussions en classe pour aider les étudiantes et étudiants à déterminer ensemble les éléments qu’elles et ils ont le pouvoir d’influencer et de changer dans leur domaine d’études.
- Favorisez le développement des compétences civiques pertinentes (comme la pensée critique, la culture scientifique et la communication), et discutez de leur importance pour l’avenir personnel et professionnel.
- Organisez des activités de réflexion qui aideront vos étudiantes et étudiants à appliquer leurs compétences et connaissances dans divers types d’emploi et contextes sociaux.
Ces stratégies ne nécessitent pas beaucoup de temps en classe, et elles pourraient aider à préparer vos étudiantes et étudiants pour l’avenir.
Poursuivons la conversation
Qu’avez-vous entendu dire en classe sur le contexte actuel? N’hésitez pas à commenter ci-dessous. Pour d’autres conseils sur l’enseignement, la rédaction et la gestion du temps, consultez le blogue Substack de Loleen (en anglais), https://loleen.substack.com/Academia Made Easier.
J’ai hâte de vous lire. À la prochaine, et portez-vous bien.
Postes vedettes
- Architecture - Professeur adjoint / professeure adjointeUniversité McGill
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (autochtone, programme anglophone)Université d'Ottawa
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (didactique de l’activité physique et sportive, santé et bien-être - poste francophone)Université d'Ottawa
- Chaire de recherche, niveau 2 dédiée à l’étude de la motivation et du mieux-être au travailUniversité du Québec à Trois-Rivières
- Médecine - Professeure adjointe / agrégée ou professeur adjoint / agrégé (génétique humaine, génomique, droit et politiques)Université McGill

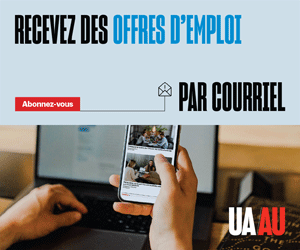

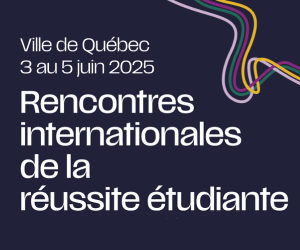












Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.
1 Commentaires
C’est une actualité partout dans le monde. C’est une bonne réflexion. juste, je vous propose de former tous les enseignants pour ça, sans exception. Car l’hétérogénéité des enseignants rend les choses difficiles. c’est pour cette raison, il faut une initiative générale en appliquant toute la partie prenante et surtout ne pas normaliser dans toutes les institutions supérieures, car elles ne sont pas toutes pareil. Merci.