Revoir la culture dominante dans les programmes de doctorat
On continue de faire valoir implicitement la supériorité des emplois au sein du corps professoral.

Ma collation des grades a été plutôt intime. J’arrivais même à repérer ma famille dans la foule. Le public était peu nombreux, mais je faisais partie d’un groupe exceptionnellement assez nombreux d’étudiants en histoire recevant leur doctorat ce jour-là. Sur les 14 inscrits au programme, nous étions environ 10 à la cérémonie, heureux d’amorcer une carrière dite « non traditionnelle ». Notre groupe comptait un conseiller en développement économique, un professeur d’école culinaire, un rédacteur en chef de magazine et le cofondateur d’un organisme de sensibilisation du public de Toronto. J’avais eu la chance d’obtenir, environ deux mois avant ma soutenance de thèse, un emploi de gestionnaire universitaire des initiatives de formation professionnelle aux cycles supérieurs. Nous étions heureux de nous retrouver tous ensemble sur le campus pour célébrer les réalisations de notre cohorte. Malheureusement, les festivités ont été de courte durée.
Après la cérémonie, le département d’histoire avait organisé une belle réception pour les diplômés et leur famille. De nombreux professeurs m’ont posé des questions sur mon travail et m’ont demandé si je m’y plaisais. « Je fais de la recherche et de la promotion d’intérêts, j’écris, j’établis des liens, j’enseigne, je discute, je crée et j’apprends », leur ai-je répondu. J’ai expliqué que je ne me sentais plus coupable de consacrer mes temps libres à autre chose que le travail (faire du sport, regarder la télévision ou lire un roman), comme c’était le cas pendant mes études supérieures. J’ai raconté que je travaillais avec des collègues incroyablement intelligents et passionnés, qui avaient acquis une foule d’expériences intéressantes hors du milieu universitaire. À leur tour, mes amis ont parlé de leurs carrières et objectifs professionnels respectifs. Il me semblait que tout le monde était heureux et enthousiaste face à l’avenir.
Vers la fin de la réception, j’ai remarqué qu’un membre du corps professoral discutait avec mon conjoint et mes parents. Lorsque je me suis jointe à eux, il m’a félicitée, en ajoutant qu’il était en train d’expliquer à ma famille à quel point « tout le monde » avait été étonné que « j’abandonne ». Il voulait de toute évidence dire que j’avais tourné le dos à une carrière de professeur. En résumé, il racontait aux membres de ma famille, qui venaient de passer deux heures à traverser Toronto à l’heure de pointe, avaient enfilé de beaux vêtements et m’avaient acheté des fleurs hors de prix pour souligner ma réussite, que j’avais échoué. Il n’en était évidemment pas conscient et pensait me faire un compliment. Plus tard, j’ai appris qu’il avait aussi souligné que j’étais très respectée, intelligente et travaillante. Selon lui, si seulement j’avais essayé, si je n’avais pas « abandonné », j’aurais pu « réussir ». Ces commentaires m’ont blessée, mais ils ne m’ont pas étonnée.
Mon but n’est pas d’embarrasser le professeur en question, mais de témoigner des difficultés rencontrées par ceux qui ne respectent pas le « plan A » des programmes de doctorat à l’échelle du pays. Rien ne changera vraiment tant que les mentors des étudiants continueront d’insinuer, de façon implicite ou explicite, que le corps professoral est la seule voie professionnelle vraiment valable pour les meilleurs étudiants, et que tout le reste est un plan B ou une solution de rechange.
Je ne cherche pas à minimiser les efforts déployés par les universités, les départements et les professeurs (conjointement avec les centres de carrières, les bureaux des études supérieures et les services d’aide aux étudiants) pour combattre cette perception. Je veux simplement souligner que les changements qu’ils apportent aux politiques, aux programmes et aux ressources ne sont en fin de compte qu’un pas dans la bonne direction. Les propos, la culture et les attentes avec lesquels les doctorants composent au quotidien lors des réunions de comités, des activités sociales départementales et des conversations les plus banales sont tout aussi importants.
Même s’il est beaucoup mieux vu qu’avant pour un étudiant aux cycles supérieurs de parler ouvertement de ses aspirations professionnelles hors du corps professoral, et beaucoup moins acceptable pour les professeurs de dire (du moins explicitement) que l’enseignement est la seule carrière digne de ce nom pour un doctorant, la culture du « plan A » continue d’être très subtilement valorisée. Le roulement des yeux qui accompagne trop souvent les mots tels que « compétences » et « professionnalisation » dans le milieu universitaire le démontre bien, tout comme les remarques méprisantes sur l’administration universitaire, où de nombreux titulaires de doctorat finissent par aboutir. L’idée est aussi renforcée par le fait que la permanence est présentée comme le seul cadre possible pour mener des travaux de recherche novateurs et utiles. Elle est si tenace que le professeur qui a parlé de mon « abandon » à ma famille ne réalisait probablement même pas que sa remarque puisse être considérée comme autre chose qu’un commentaire positif sur mon potentiel et mes capacités.
La culture du « plan A » est aussi renforcée par les professeurs qui, pleins de bonnes intentions, se croient particulièrement responsables lorsqu’ils informent gentiment les futurs doctorants qu’il n’y a pas de postes, ce qui est aussi faux qu’irresponsable. Les possibilités intéressantes d’emploi et (mieux encore) de carrière pour les doctorants ne manquent pas. Le problème est que nous n’arrivons pas à reconnaître qu’une carrière à l’extérieur du corps professoral peut être gratifiante, et à quel point un titulaire de doctorat peut être précieux pour différents secteurs et industries.
Heureusement, malgré ces difficultés, les titulaires de doctorat arrivent à trouver des emplois stimulants à l’extérieur du corps professoral (voir les récentes études du Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur et de l’Université de la Colombie-Britannique). Bon nombre d’entre eux ont sans aucun doute été inspirés par les anciens étudiants qui ont participé bénévolement à des tables rondes sur les carrières hors du milieu universitaire. D’autres ont été conseillés par les employés du centre de carrières, qui leur ont appris à prendre conscience de leurs compétences et de leurs possibilités. Certains ont peut-être même eu la chance de discuter de compétences exploitables et d’options de carrière différentes lors de leurs séminaires. Il faut à présent s’attarder à la culture universitaire qui forge les attentes, les objectifs et l’identité des étudiants. J’invite donc les conseillers, les professeurs et les directeurs de département à songer à l’influence qu’ils ont involontairement sur la perception de réussite et d’échec de leurs étudiants. Ils doivent rectifier le tir pour que les titulaires de doctorat puissent célébrer leurs réussites hors du milieu universitaire sans qu’on leur donne l’impression d’avoir échoué.
Postes vedettes
- Droit - Professeur(e) remplaçant(e) (droit privé)Université d'Ottawa
- Doyen(ne), Faculté de médecine et des sciences de la santéUniversité de Sherbrooke
- Chaire de recherche du Canada, niveau 2 en génie électrique (Professeur(e))Polytechnique Québec
- Medécine- Professeur.e et coordonnateur.rice du programme en santé mentaleUniversité de l’Ontario Français
- Littératures - Professeur(e) (Littérature(s) d'expression française)Université de Moncton












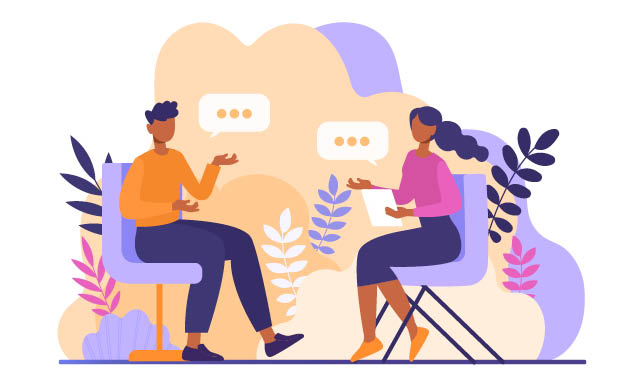





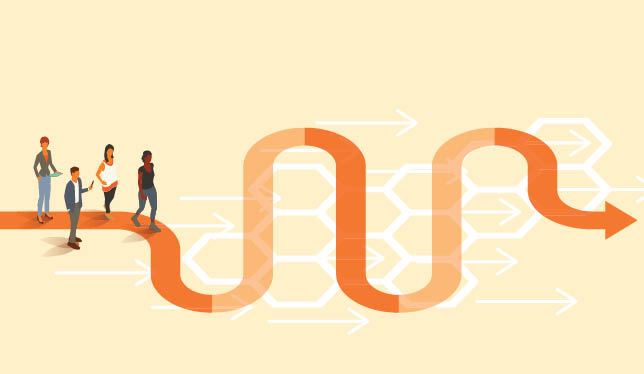
Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.
2 Commentaires
Merci pour ce beau témoignage. Je comprends tout à fait ce que tu as vécu. Après 4 ans suite à l’obtention de mon doctorat, je ne me sens plus coupable moi non plus de ne pas occuper un poste de professeure. Je suis très heureuse de pouvoir dormir, avoir des loisirs, ne rien faire le soir si j’en ai envie et profiter de mes fins de semaine. Ça n’a pas de prix! Bravo!
Merci aussi pour ce témoignage combien révélateur et peu publicisé par les universités (merci aux médias qui rapportent ces cas). Je partage ce commentaire quant à savoir une forme de déception s’installe 4 ans après l’obtention du diplôme sans obtenir un poste de professeur permanent où la résignation prend place. Toutefois., Je tiens toutefois à préciser qu’il possible de mener une carrière « parallèle » universitaire. Par exemple, au Canada anglais, comme au Québec français, en France (maîtres de conférence) et aux É.U. (fellow professor),. beaucoup de détenteurs de Ph.D. sont soit chargés de cours (professeur à temps partiel), professeur associé, invité ou chercheur principal en même temps, ce qui leur confère plusieurs statuts d’emploi dans plus d’une université. Cette situation n’est pas la carrière classique universitaire, mais il semble que ce soit la voie à venir pour les prochains. Ces gens doivent travailler plus que « les professeurs réguliers » (heures/semaines), mais leur rémunération est parfois supérieure à celles des professeurs titulaires. Leurs travaux avancent plus vite que ceux qui détiennent la permanence dans certains cas, motivation oblige. Ces « temporaires » continuent à être vus dans les congrès scientifiques chaque été. Évidemment, la conciliation travail-famille en prend un coup, mais avec une bonne organisation il est possible de s’en tirer. Qui a dit que les Canadiens travaillaient 5 heures de plus en 2018 vs 1990 (Premier ministre Trudeau, 2017)? Par conséquent, cessons d’attendre après les universités et allons chercher la gratification et la reconnaissance selon nos propres schèmes de valeurs.