Ingérence politique dans la recherche: le Canada et le Québec également en terrain vulnérable
Lettre ouverte de la communauté historienne

Ceci est une lettre ouverte. Pour voir la liste des signataires et signer : cliquer ici
La Maison Blanche a déclaré la guerre à la pensée critique en histoire, en particulier en histoire nationale. Le 27 mars, le président américain a signé un décret intitulé Restoring Truth and Sanity to American History. Dans ce cadre qui fait ouvertement abstraction de la diversité des expériences du passé, et qui pathologise les histoires inclusives ainsi que les personnes qui les produisent et les peuplent, le décret qualifie de « corrosive » toute évocation des inégalités de race ou de genre dans l’histoire.
Concrètement, le décret vise à éliminer toute mention de ce type, et globalement toute forme d’histoire critique, dans les monuments et les institutions de mémoire relevant du gouvernement fédéral. Il applique à l’histoire la dangereuse rengaine voulant que nommer les inégalités soit « idéologique », tandis que les ignorer serait « objectif et factuel ». La mesure prévoit utiliser l’arme budgétaire pour purger l’Institution Smithsonian et ses musées de l’« idéologie inappropriée ». Les principaux établissements touchés sont les musées d’Art américain, d’Histoire et culture afro-américaines ainsi que d’Histoire des Américaines.
Le passage du décret concernant le Smithsonian s’inscrit dans la lignée d’autres décrets similaires, dont celui sur le nécessaire retour d’une éducation patriotique dans les écoles primaires et secondaires (« Ending Radical Indoctrination in K-12 Schooling » – 29 janvier 2025). Ce dernier en appelle notamment au retour d’un enseignement axé sur une présentation « inspirante » et « ennoblissante » des principes fondateurs des États-Unis et à la « célébration de la grandeur et de l’histoire des États-Unis ».
Dans les deux cas, il s’agit de taire ou de tordre les faits pour qu’ils soient mis au service d’une certaine conception de la nation et du passé. Nous n’assistons pas seulement à la censure de certaines interprétations de l’histoire, mais à la disparition de certains programmes et à l’effacement des faits eux-mêmes. Plus précisément, il s’agit de mentir par omission ou par distorsion, en oblitérant des faits avérés. C’est peu dire que la vérité historique, que le décret convoque sans nuance, est loin d’être servie ici. Cette démarche est contraire à l’éthique historienne et à l’éducation citoyenne.
Ces distorsions ne déforment pas seulement le récit de l’histoire américaine ; elles façonnent aussi le paysage même du pays en y inscrivant, sous forme matérielle, les hiérarchies raciales du passé. Les statues confédérées, par exemple, que le président Trump veut remettre à leur place, ne se contentent pas de glorifier un passé mythifié : elles incarnent et perpétuent un rapport de pouvoir. Ce pouvoir se fait sentir avec une intensité particulière – et de manière délibérée – chez la population Afro-américaine, déjà confrontée à des dynamiques de marginalisation aux États-Unis.
Rappelons que ces décrets sont adoptés en pleine vague d’attaques contre le financement, la gouvernance et l’indépendance des universités américaines. Il y a donc, d’un côté, une offensive contre la possibilité même de réaliser des recherches historiques indépendantes et de l’autre, une ingérence de l’État dans les institutions d’histoire publique et par rapport au récit national imposé. S’ajoute à cela la suppression de subventions et de bourses, y compris la résiliation des bourses Fulbright. Les universités réticentes au risque annulent désormais les interventions d’intervenants controversés par crainte de représailles (par exemple, NYU) ou acceptent de nouveaux mécanismes de contrôle des enseignements dispensés dans les salles de classe (Columbia). La liberté académique est gravement menacée.
Aux États-Unis, la communauté historienne s’organise pour répondre à ces attaques. Le 13 mars dernier, trente-cinq associations historiques, dont l’American Historical Association et l’Organisation des historiens américains, publiaient une déclaration commune condamnant « les récents efforts visant à censurer le contenu historique des sites-Web du gouvernement fédéral », y compris les directives qui « donnent insidieusement la priorité à une idéologie étroite au détriment de la recherche historique, de l’exactitude historique et des expériences réelles des Américains ».
Soyons clairs : l’approche globale de l’administration Trump face à la discipline historique vise à rebâtir un récit national américain vidé de toute inclusivité et de toute nuance, qui servira d’abord à propulser le discours politique officiel. Ce projet ressemble à celui qu’impose Vladimir Poutine en Russie depuis vingt ans, par « toute une série de mesures qui dessinent les contours d’une véritable “politique de l’histoire” de plus en plus agressive au fil des années. » Pourtant, l’une des grandes leçons du XXe siècle est que le recours à des récits historiques tronqués, partiaux, univoques et déformés représente une puissante arme entre les mains des propagandistes et des bellicistes, lesquels conduisirent l’humanité à la destruction physique, matérielle et culturelle.
Faut-il rappeler que l’histoire, comme toute connaissance, ne progresse pas à coups de décrets ? De même, elle n’appartient à personne en propre, et encore moins à la raison d’État. Elle s’élabore plutôt dans le débat, la discussion et la dialectique, nourrie par la réflexivité, le doute et une certaine conscience de nos limites. S’être dotée de règles professionnelles et méthodologiques, s’élaborer dans un espace autonome et réflexif, à distance des injonctions politiques extérieures, font partie de ses grands acquis. C’est à partir de ce territoire fragile, toujours en négociation, que l’histoire peut proposer des connaissances étayées, établir des relations avec les musées et autres milieux de diffusion et, bien sûr, nourrir le débat démocratique. La conversation démocratique et la pensée critique sont les acquis les plus importants de notre métier. Le milieu historien au Québec et au Canada en témoigne : traversé par ses débats et controverses, il demeure un milieu collégial qui se reconnaît par une pratique professionnelle rigoureuse et un dialogue respectueux.
Or, ce qui se passe actuellement aux États-Unis porte directement atteinte à ces principes fondamentaux de la science historique. Bien que relativement préservés à ce jour, le Canada et le Québec ne sont pas complètement à l’abri d’un tel virage autoritaire, d’autant que ces mêmes courants réactionnaires sont présents chez nous. En pleine campagne électorale, il serait rassurant d’entendre la classe politique rappeler l’importance de la liberté académique à tous égards et souligner la pertinence des études historiques, peu importe le sujet et l’angle abordés. Notre inquiétude est grande face au retour d’une pensée liberticide. Le plus récent décret de Trump sur le Smithsonian est de cet acabit; il prône un récit acritique, à la gloire des puissants tout en niant les rapports de force qui caractérisent les relations de race ou de genre.
L’histoire est une pratique démocratique et pluraliste, qui veut émanciper les individus grâce au savoir. Elle est attaquée dans ses fondements par les menaces actuelles, qui assimilent le savoir à l’insanité et la nuance à l’inefficacité. À ces falsifications, nous rétorquons vigoureusement ceci : le savoir et la nuance ne sont pas des aveux de faiblesse. Au contraire, ils traduisent la complexité de la réalité et nous affranchissent de l’ignorance.
Postes vedettes
- Vice-rectrice ou vice-recteur à la formation et à la rechercheUniversité du Québec à Rimouski
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (didactique de l’activité physique et sportive, santé et bien-être - poste francophone)Université d'Ottawa
- Doyenne ou doyen, Faculté d’éducationUniversité de Sherbrooke
- Doyenne ou doyen - Faculté de génieUniversité de Sherbrooke
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (autochtone, programme anglophone)Université d'Ottawa

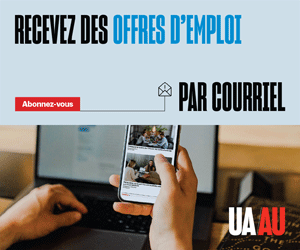

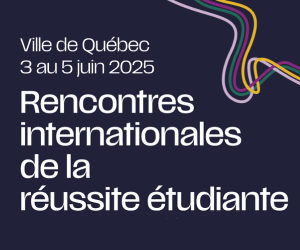






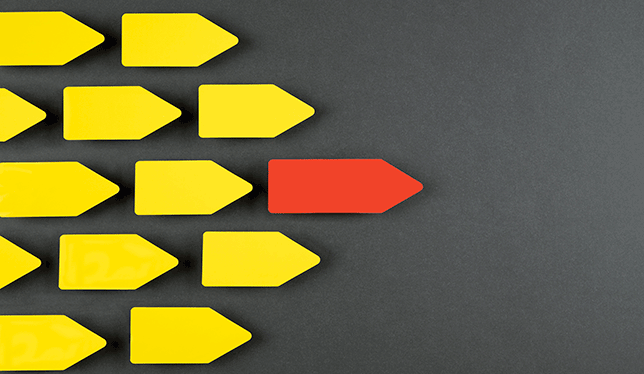
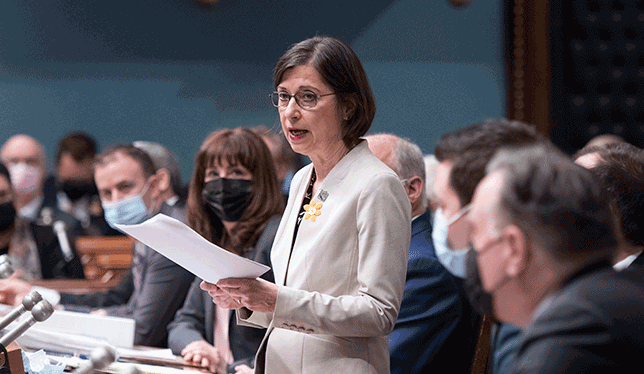
Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.