L’intelligence artificielle transforme l’enseignement universitaire. Comment s’adapter?
Corps professoral, cadres, membres du personnel… Tout le monde doit participer à la discussion sur l’IA.

Pour savoir comment le secteur s’adapte aux changements technologiques, j’ai participé dernièrement à un sommet canadien sur l’intelligence artificielle (IA) en enseignement supérieur (AI-Cademy : Canada Summit for Post-Secondary Education). Voici les points saillants de mon expérience — et les interrogations qui persistent. Précisons que je fais ici référence à l’IA agentique, cette forme d’IA qui prend des initiatives, puisque son intégration dans le monde universitaire est tout aussi inévitable que celle de l’IA générative.
Utilisation de l’IA dans l’enseignement supérieur : ce que j’ai appris
Charge de travail du corps professoral : L’IA pourrait simplifier considérablement une partie du travail enseignant. Lors du sommet, j’ai vu un outil d’IA générer en moins d’une minute une série de questions à choix multiples à partir d’un article. On peut en effet s’en servir pour créer rapidement des éléments qui facilitent la conception de cours (objectifs d’apprentissage, structure des travaux, grilles d’évaluation), la planification des leçons (diapositives, études de cas, activités d’apprentissage) et l’offre de matériel complémentaire (vidéos, images, balados).
Il va sans dire que la personne qui donne le cours devra tout de même valider et, au besoin, retravailler le contenu généré. Ayant moi-même passé un nombre incalculable d’heures à fignoler chaque question d’examen et chaque diapo de cours, je mesure parfaitement tout le temps qu’on pourrait gagner. Je connaissais déjà certains des usages possibles (voir mon article sur les manières d’utiliser l’intelligence artificielle générative en enseignement, coécrit avec Erin Aspenlieder — en anglais seulement), mais quand j’ai appris qu’on pouvait se servir d’un « syllabot » pour répondre aux questions sur le plan de cours, je ne tenais plus en place.
Évolution des compétences : L’événement m’a aidée à mieux comprendre en quoi l’évolution du travail et de la société redéfinira les compétences nécessaires à la réussite étudiante. La capacité à formuler et à définir les problèmes, à exercer sa pensée critique — une compétence que les universités cultivent depuis longtemps — revêtira une importance toute particulière à l’ère de l’IA.
En même temps, certaines habiletés risquent de passer à l’arrière-plan, voire de disparaître, faute d’occasions de les utiliser ou de les perfectionner. C’est là qu’il faut jouer de prudence et de discernement. Il y a longtemps que je ne sais plus me servir d’une microfiche ou d’un catalogue sur fiches, alors que c’était une nécessité quand j’étais étudiante. Et non, malgré ce que mes élèves semblent croire, je ne suis pas assez vieille pour avoir appris à utiliser un abaque!
Le progrès technologique entraînera toujours la perte de certaines compétences, c’est normal; mais il y a des savoir-faire qu’il faut préserver coûte que coûte. En tête de liste, l’art d’écrire. Écrire, c’est bien plus que produire un texte : c’est un processus qui permet de clarifier, de faire évoluer et d’affiner sa pensée. Le milieu de l’enseignement doit penser dès maintenant à des moyens de préserver l’écriture comme forme de réflexion. Mais ce n’est qu’un exemple : bien d’autres compétences transmises dans le cadre des études supérieures présentent de précieux avantages que l’IA ne doit pas remplacer.
Potentiel de collaboration : Le contexte actuel présente une occasion en or d’apprentissage commun pour les universités canadiennes, qui subissent d’importantes pressions financières. Tous les établissements doivent composer avec la montée de l’IA. Il y a fort à parier qu’en voulant chacune développer leurs protocoles, politiques et plateformes, les universités risquent de multiplier les chevauchements inutiles. Pour l’instant, on avance encore à tâtons. Pourquoi ne pas miser sur la collaboration — entre établissements d’une même province ou de taille similaire, par exemple — pour trouver des solutions?
Utilisation de l’IA dans l’enseignement supérieur : mes interrogations
Participation du corps professoral : L’IA est en train de redéfinir la société et le monde du travail. Les universités n’auront pas le choix de s’adapter pour ne pas se faire distancer. L’avenir de l’enseignement supérieur se dessinera-t-il avec les conseils — ou au moins, la participation active — du corps professoral, ou sans lui? Je crains qu’on ne crée des outils d’IA peu satisfaisants et qu’on ne laisse la concurrence mener le bal.
Les fournisseurs de produits d’IA destinés au secteur de l’enseignement supérieur ne manqueront pas. Le problème, c’est que beaucoup de ces outils risquent de s’appuyer sur des données recueillies aux États-Unis — et d’être conçus pour ce pays. Comment le corps professoral et les établissements d’enseignement supérieur canadiens peuvent-ils collaborer avec les fournisseurs pour veiller à ce que les solutions d’IA achetées tiennent compte du contexte canadien (besoins, perspectives, valeurs culturelles)?
Il ne faut pas se leurrer, il y aura également toute une panoplie de solutions destinées à remplacer ou à contourner les études supérieures. Dans un monde idéal, les universités canadiennes offriraient rapidement des solutions de rechange intéressantes pour les étudiantes et étudiants. Là aussi, l’engagement du corps professoral est essentiel. Le leadership universitaire et les centres d’enseignement et d’apprentissage auront certes un important rôle à jouer, mais c’est l’expertise du corps professoral qui devra orienter la transformation des programmes.
Possibilités d’éducation libérale : Qu’on l’accueille en classe et permette de l’utiliser pour les examens ou qu’on l’interdise catégoriquement et qu’on privilégie les évaluations traditionnelles, l’IA influe déjà sur les méthodes pédagogiques. Mais changera-t-elle également le contenu enseigné?
L’essor de l’intelligence artificielle pourrait bien raviver l’intérêt de la société et de la population étudiante pour les compétences intrinsèquement humaines (aptitudes interculturelles, collaboration, écoute active, etc.), l’éthique et la justice, et la pensée multidisciplinaire. Dans ce cas, l’IA redonnera-t-elle de l’élan aux arts libéraux traditionnels (les sciences humaines et sociales) et aux programmes interdisciplinaires qui les enseignent?
Il y a lieu de se demander ce qu’un tel virage impliquerait pour les STIM. Les bouleversements économiques et sociétaux engendrés par l’IA susciteront-ils un intérêt accru pour les programmes d’éducation libérale, avant même la formation professionnelle? Selon l’Association américaine des collèges et des universités, l’éducation libérale est « une approche d’enseignement qui donne les outils nécessaires pour faire face à la complexité, à la diversité et au changement » et « offre une connaissance générale du monde dans son ensemble (science, culture, société, etc.) combinée à une spécialisation dans un domaine particulier. Elle aide les étudiantes et étudiants à développer un sens de la responsabilité sociale ainsi qu’un ensemble de compétences intellectuelles et pratiques transférables, comme la communication, la pensée analytique, la résolution de problèmes et la capacité à mobiliser concrètement ses acquis. » Pour les professeures et professeurs qui ne souhaitent pas voir l’éducation s’axer autour de la carrière, c’est une bonne nouvelle.
Connexion humaine : Un sujet qui revient souvent chez les étudiantes et étudiants, c’est le désir de créer des liens. Ça me rassure, d’autant plus que j’ai ce même besoin : je ne veux pas parler à un robot ou à un système automatisé, mais à un être humain. L’importance de la connexion et des relations humaines en enseignement supérieur impose bien heureusement des limites aux fonctions assumées par l’IA. Il s’agit maintenant de trouver comment s’en servir pour aider à leur tour les personnes qui instruisent, conseillent et encadrent la population étudiante, par exemple en allégeant la charge de travail des conseillères et conseillers pédagogiques pour leur permettre de consacrer plus de temps aux rencontres individuelles.
Utilisation de l’IA dans l’enseignement supérieur : appel à l’action
L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’économie et la société apporte son lot de possibilités, de défis et de questions, dont le secteur doit absolument discuter. Je vous invite toutes et tous, peu importent votre rôle (corps enseignant, cadre, personnel) et vos sentiments à l’égard de l’IA (enthousiasme, curiosité, scepticisme), à participer à la réflexion.
Poursuivons la conversation
À votre avis, quelles répercussions l’IA aura-t-elle sur l’enseignement supérieur? N’hésitez pas à me transmettre vos commentaires ci-dessous.
J’ai hâte de vous lire. À la prochaine, et portez-vous bien.
Postes vedettes
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (didactique de l’activité physique et sportive, santé et bien-être - poste francophone)Université d'Ottawa
- Vice-rectrice ou vice-recteur à la formation et à la rechercheUniversité du Québec à Trois-Rivières
- Architecture - Professeur adjoint / professeure adjointeUniversité McGill
- Éducation - Professeure adjointe ou professeur adjoint (autochtone, programme anglophone)Université d'Ottawa
- Chaire de recherche, niveau 2 dédiée à l’étude de la motivation et du mieux-être au travailUniversité du Québec à Trois-Rivières


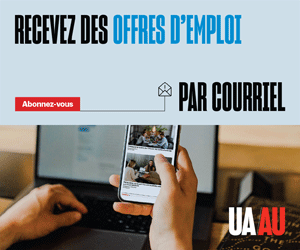

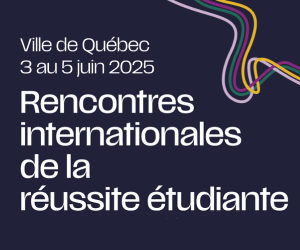





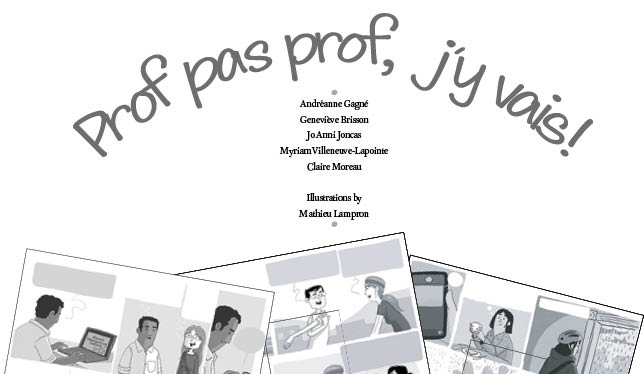


Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.