Plaidoyer pour l’écriture inclusive et non-binaire
L’écriture inclusive, bien plus qu’une question de style, est un outil puissant pour rendre visible la diversité des genres et ouvrir la langue française à des pratiques plus inclusives et égalitaires.
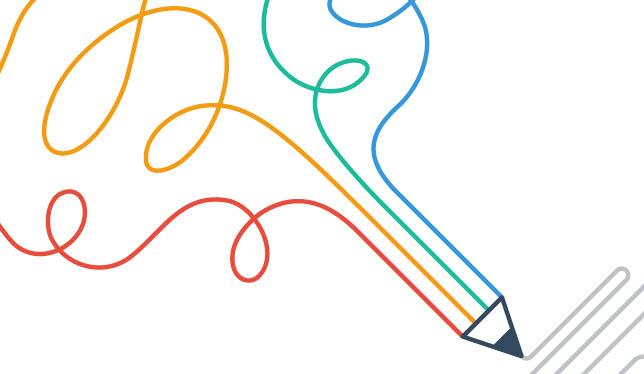
L’écriture – cette série de mots imprimés, distribués, lancés pour un lectorat – fait plus que porter un sens. En deçà de ce qu’elle dit et de la manière dont elle le dit, il demeure ce qu’elle fait en le disant. Parler n’est jamais neutre, écrivait Luce Irigaray; écrire ne l’est pas davantage. L’écriture inclusive, sous ses divers aspects, permet de contrecarrer les effets d’exclusion et de discrimination enchâssés dans la langue française. Elle mérite donc d’être explorée et pratiquée davantage.
L’écriture vise un lectorat; la manière de s’y adresser en dessine les contours, elle inclut et exclut à la fois, elle renforce des manières de dire qui renforcent des manières de faire. Une prose complexe, cousue de jargon spécialisé, définit les limites du lectorat autant qu’un formulaire de consentement dont le niveau est évalué par intelligence artificielle. Parler, écrire, a un effet immédiat sur la personne qui entend ou lit, qui se sent visée ou non, qui participe à définir les attentes et la norme quant à ce qui est dit en étant interpellée, interpellable, ou non-interpellable… nommé·e, jamais nommé·e, nommable ou innommable.
D’où l’importance de bien nommer les genres et de contribuer à la visibilité de celleux qui demeurent invisibles dans nos phrases comme dans la langue. Ne serait-ce que parce que le français appose un genre à tout, mais ne permet pas de dire aussi directement toute la diversité des genres.
En effet, pas plus que la langue, le genre n’est pas une donnée naturelle, définie d’avance pour nous. Le sexe, si l’on maintient une distinction entre sexe et genre, est aussi multiple et aucunement binaire. Et au minimum, même sans ancrage dans les corps, le codage binaire du genre n’existe pas dans toutes les langues (le latin et l’islandais ont un genre neutre) et toutes les langues ne sont pas genrées (le nêhiyawêwin différencie plutôt entre ce qui est animé ou inanimé).
Comment écrire alors? La rédaction épicène fonctionne, mais continue à rendre invisible la diversité des genres et à faire que les personnes ni masculines ni féminines sont absentes de la plupart des textes. Viser la neutralité, bien que cela soit déjà une bonne pratique, ne résoudra donc pas tous les problèmes.
Surtout qu’il n’y a pas de genre neutre en français. Le masculin est simplement dit inclure le féminin. Comme tout fait de langue, il s’agit d’une convention. Toutefois, on peut retrouver l’émergence de cette convention dans une campagne pour régulariser non seulement la langue, mais avec elle, les vies et les options des femmes. Le fait d’ajouter une note au début d’un texte déclarant que le masculin est ou se veut inclusif du féminin n’y change rien. Cette pratique est étrange, puisqu’elle ne nomme que ce qui est déjà évident, et ne fait que réaffirmer et renforcer une convention dont on connaît maintenant mieux l’histoire.
Suggérer que l’on allège le texte en se limitant au masculin est alors affirmer qu’inclure davantage de gens alourdit, ralentit, nuit. Si encore cela était vrai, cela n’expliquerait ni l’orthographe des mots « eau » ou « haies » ni les querelles sur l’accord du participe passé. Cela n’expliquerait pas davantage les efforts dont nous sommes capables au-delà de tout principe d’économie ou de simplicité, soit par jeu, soit par solidarité.
On a dit que l’usage du doublon ou surtout du point médian nuirait à la beauté de la langue. Mais quelle langue? Ces usages ne détonnent qu’en relation au style auquel nous sommes habitué-es, qui est lui-même défini historiquement et régionalement. S’il y a effort d’écriture et de lecture, ce n’est qu’en regard de nos habitudes. Et les habitudes sont justement ce que nous devons changer pour enrayer la discrimination liée au genre et au sexe.
Quand les personnes non-binaires font valoir la nécessité d’utiliser leurs pronoms, iels sont conscient·es d’amener aussi d’autres transformations dans la langue. Même s’il n’y a pas encore d’accord entre elleux quant à la manière de le faire, iels ont pu créer et suggérer plusieurs systèmes qui ont leur cohérence interne. Celui utilisé dans ce texte a, à mon avis, l’avantage d’inclure le masculin et le féminin traditionnel et d’éviter la longueur des doublons, mais aussi de mettre de l’avant la présence des personnes non-binaires dans la société comme parmi les lecteur·rices, alliant lecteurs, lectrice, lecteurices.
Je vois d’ailleurs une beauté dans cette alliance, dans cette solidarité. Le point médian me rappelle la nature conventionnelle de nos noms et adjectifs, me ramène à la créativité de la langue, et ne nuit aucunement à la compréhension du texte. La lecture à voix haute ne pose pas immédiatement problème tant que le point médian est bien utilisé (et je préfère encore dire « auteurices » que « auteurs et autrices »). La lecture par machine pour personnes ayant une incapacité visuelle est évidemment un autre problème, dont la solution tient peut-être à une plus grande accessibilité dans ces technologies.
Les choix quant à l’écriture demeurent pour la plupart une question de style. Changer son écriture, ajouter des manières de faire apparaître et de viser ses lecteur·rices ne conviendra sans doute pas à tout le monde. Là où il y a un désir de bien rejoindre l’ensemble du lectorat ou de changer les habitudes, chacun·e devrait penser à ses pratiques quant au genre dans l’écriture.
Au minimum, les politiques de rédaction doivent donner aux auteur·rices la chance de faire l’essai de ces nouvelles manières d’écrire. Cette ouverture, là où elle existe pour un petit nombre d’écrivain·es, permet déjà de présenter l’écriture inclusive comme une option, de rappeler l’existence d’une diversité de genres et d’habituer le lectorat à l’usage de divers pronoms. Elle permet également de ne pas trancher le débat trop rapidement. En effet, nous ne savons pas où ces pratiques nous mèneront et si d’autres idées et pratiques seront suggérées. Pourquoi alors ne pas essayer ce que la langue rend déjà possible, à savoir trouver de nouvelles manières de communiquer et d’entrer en relation?
Jérôme Melançon est professeur titulaire au département de philosophie à l’Université de Regina.
Note éditoriale
Dans notre engagement en faveur d’une langue inclusive et respectueuse, nous avons opté pour une approche qui privilégie des termes épicènes et des expressions englobantes. Par exemple, au lieu de recourir aux points pour marquer le genre, nous privilégions des formules comme « personne étudiante » ou « corps professoral » qui permettent d’inclure chacun et chacune sans affecter la fluidité de la lecture.
Cette semaine, nous publions toutefois une chronique qui défend l’usage des points dans l’écriture inclusive. Nous croyons qu’il est essentiel d’ouvrir notre tribune aux différents points de vue sur des sujets d’actualité et d’intérêt pour nos lecteurs et lectrices. Cette diversité d’opinions alimente un débat sain sur la façon dont la langue française peut évoluer vers plus d’inclusivité.
Postes vedettes
- Chaire de recherche du Canada, niveau 2 en génie électrique (Professeur(e))Polytechnique Québec
- Doyen(ne), Faculté de médecine et des sciences de la santéUniversité de Sherbrooke
- Littératures - Professeur(e) (Littérature(s) d'expression française)Université de Moncton
- Medécine- Professeur.e et coordonnateur.rice du programme en santé mentaleUniversité de l’Ontario Français
- Droit - Professeur(e) remplaçant(e) (droit privé)Université d'Ottawa

















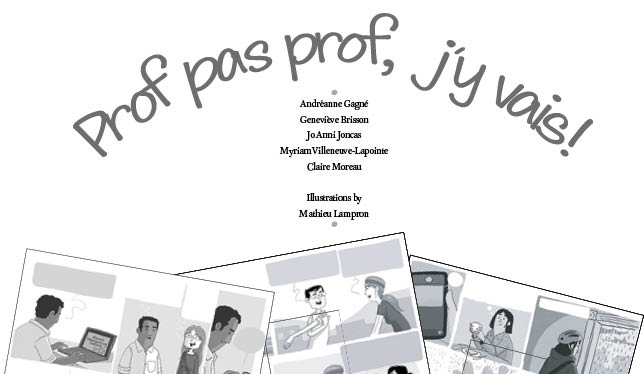
Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.