Un scientifique ne peut pas se tromper, il le doit!
Ce qui pourrait apparaître comme un échec était pourtant une petite avancée scientifique : nous n’avions pas montré ce qui était, mais nous avions montré ce qui n’était pas.

Cet article a été publié à l’origine sur le site Web The Conversation. Lisez l’article original.
Il y a quelques semaines de cela, j’ai quitté le confort de mon bureau pour aller à la rencontre d’élèves. J’y allais pour parler de mon travail de chercheur avec des élèves de 6e année. J’avoue avoir été plus stressé à la perspective de cette rencontre que lorsqu’il s’agit de présenter mes travaux à un parterre de scientifiques. Les élèves ont été à la hauteur de mon appréhension. Ils m’avaient concocté un assortiment de questions toutes aussi pertinentes que déstabilisantes. Déstabilisantes parce que dans la course du quotidien, entre rapports, expérimentations, travail avec les étudiants et autres joies administratives, je ne prends pas le temps de me les poser. À tort.
Je passe sur les questions qui m’ont pris au dépourvu (« Pouvez-vous décrire votre travail en seulement quatre mots? » – Je ne pensais pas rencontrer un responsable RH!). Je vais n’en retenir qu’une qui m’a fait cogiter plus que les autres : « Est-ce que ça vous arrive souvent de rejeter vos hypothèses? »
Dans l’esprit d’un élève de sixième (et de beaucoup, beaucoup de monde), la science est un processus linéaire : observation → hypothèse → expérimentation → interprétation → conclusion. Ce schéma idéal(iste) est bien loin de la réalité, mais ce qui est important ici, c’est bien de voir que pour cet élève, si l’expérimentation ne permet pas de vérifier l’hypothèse, alors c’est que l’on s’est trompé. D’où la phrase que tous les enseignants de biologie ou de physique ont entendu un jour : « Hé m’dame (m’sieur)! Ça marche pas! »
« Ça marche pas »
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une expérience peut échouer à vérifier l’hypothèse de départ. D’abord, si l’hypothèse est formulée en dehors de tout cadre théorique initial, il y a peu de chances que l’expérience marche. Si je fais l’hypothèse que le ciel est bleu parce qu’il existe un drap géant au-dessus de nos têtes, j’aurais beau expérimenter tous les projectiles et toutes les fusées au monde, je n’arriverai pas à déchirer ce drap. « Ça marche pas ». Cet exemple est certes quelque peu absurde, mais il me permet de rappeler qu’il n’y a pas d’observation sans cadre théorique sous-jacent. Je ne vois que ce que j’ai été préparé à voir. Comme chercheur, pour éviter que les expériences que je réalise ne « marchent pas », je ne peux donc pas me permettre de partir à l’aveugle. Je m’appuie au contraire sur les résultats qu’ont obtenus mes collègues avant moi et qu’ils ont rapportés dans des articles scientifiques.
Ensuite, l’expérience peut « ne pas marcher » parce que l’on ne s’est pas donné les moyens de la mettre en œuvre correctement. Soit que l’on a utilisé un matériel non adapté, soit que l’on a manqué de rigueur, soit que l’on n’a pas répété l’expérience un nombre suffisant de fois pour réduire le poids des événements aléatoires dans les observations. On touche alors à la question des statistiques. Même la plus rigoureuse des expérimentations ne peut pas tout contrôler (c’est particulièrement vrai en biologie ou en écologie).
Récemment, je me suis intéressé aux effets de la sécheresse sur la manière dont les arbres se défendent contre les insectes herbivores. Sur la base de la littérature scientifique, je m’attendais à ce que les arbres stressés soient plus sensibles aux insectes herbivores que les arbres disposant d’assez d’eau. Pour le vérifier, j’ai comparé les dégâts causés par les insectes herbivores sur les feuilles de bouleau selon que ces arbres étaient soumis à la sécheresse (le témoin) ou au contraire bien arrosés (la condition expérimentale).
Pour cela, j’ai estimé la surface foliaire consommée par les herbivores. J’ai travaillé sur plus de quarante arbres dans chacune des deux modalités. J’ai constaté que les insectes causaient effectivement plus de dégâts aux arbres stressés qu’aux arbres irrigués. Mais si je m’étais contenté de comparer un seul arbre dans chaque modalité, j’aurais pu tomber par hasard sur un arbre irrigué très sensible aux herbivores, ou sur un arbre non irrigué dont les racines plongeaient directement dans la nappe phréatique. Et là, j’aurais conclu que « ça ne marche pas ».
Répéter les observations
C’est pour s’affranchir des petites différences incontrôlables qu’il est important de répéter les observations avant de conclure qu’une expérience « n’a pas marché ». En transposant cette situation au collège, on pourrait suggérer de consigner et de comparer les résultats obtenus par tous les élèves ayant réalisé la même expérimentation (et les inciter à comparer leurs résultats propres à la moyenne des résultats obtenus par l’ensemble des élèves).
Il existe un troisième cas de figure pour lequel l’expérience ne « marche pas » parce qu’elle ne peut pas marcher. Il y a quelques années, dans un travail réalisé dans la forêt des Landes, mes collègues avaient montré que la chenille processionnaire du pin se concentre en lisière des plantations de pins. Ils avaient également aussi montré que lorsque ces lisières étaient bordées par des feuillus, les pins étaient moins attaqués par la chenille processionnaire. Par la suite, en nous appuyant sur la littérature scientifique, nous avions formulé l’hypothèse selon laquelle la différence dans le niveau d’infestation des pins par la processionnaire en présence ou non de feuillus était due à une plus grande pression de prédation sur les œufs de processionnaire derrière les essences feuillues : s’il y a plus de prédation, alors il y a moins de chenilles, et donc moins de dégâts.
Nous avons testé cette hypothèse en exposant des œufs de processionnaires dans 40 pins en lisière de 10 peuplements dont la moitié de la lisière était bordée par des essences feuillues. Nous avons dénombré le nombre d’œufs consommés par les prédateurs de la processionnaire et… nous n’avons constaté aucune différence dans le taux de prédation dans les lisières en présence ou non d’essences feuillues. Ça n’avait pas marché. Hypothèse rejetée. Et pourtant nous nous avions rempli les deux critères que j’évoquais plus haut, à savoir :
- Formuler une hypothèse cohérente par rapport à l’état des connaissances scientifiques
- Réaliser un nombre suffisant de répétitions.
La science est faite d’échecs
Ce qui pourrait apparaître comme un échec était pourtant une petite avancée scientifique : nous n’avions pas montré ce qui était, mais nous avions montré ce qui n’était pas. Si ce ne sont pas les prédateurs qui expliquent les différences d’infestation des pins par la processionnaire en présence ou non d’essences feuillues, alors c’était probablement autre chose (le microclimat? l’accessibilité des arbres?). Avec notre échec, nous avons restreint le champ des possibles. Ce n’est pas une révolution scientifique, loin s’en faut, mais la science se construit aussi, et peut-être surtout, par l’accumulation de petites avancées non révolutionnaires qui viennent renforcer les théories et préciser leurs contours.
À la question « Vous est-il déjà arrivé de ne pas vérifier des hypothèses » je réponds donc sans complexe que oui! J’ajouterais que c’est normal et même extrêmement sain pour la science en général. Aux élèves qui me liraient, je dis donc « Trompez-vous! ». À leurs enseignants : « Aidez vos élèves à se tromper ». À ceux-là et à tous les autres : « Les scientifiques se trompent, et c’est aussi ce qu’on leur demande ».
Et maintenant, le point de vue du prof
À la différence du chercheur qui ne connaît pas la réponse au problème qu’il cherche à résoudre et donc qui ne sait pas si son hypothèse sera vérifiée ou pas, un enseignant doit faire construire à ses élèves un savoir déjà établi et connu par lui. Seuls les élèves sont dans la recherche d’une réponse inconnue d’eux mais détenue par d’autres. C’est une différence de taille! Car même si la démarche se veut analogue, l’objet d’étude est fondamentalement différent. Aussi, les enseignants ont tendance à sélectionner « l’hypothèse » qui va permettre d’arriver à la construction du savoir établi – même si dans le meilleur des cas ils laissent aux élèves le soin de formuler plusieurs hypothèses. Rares sont ceux qui laissent les élèves « se fourvoyer » à tester une hypothèse qu’ils savent non valide. Et pourtant l’erreur est un sacré moteur de l’apprentissage. Pour un élève, échafauder une hypothèse qu’il va pouvoir mettre à l’épreuve d’une expérience et la réfuter, est un apprentissage sûrement plus formateur pour l’esprit scientifique que de suivre un chemin tracé par d’autre.
Mauricette Mesguich, professeure de SVT et coordinatrice régionale en Nouvelle-Aquitaine du projet des collèges pilotes La main à la pâte, a rédigé le point de vue du prof dans cet article. Bastien Castagneyrol est chercheur en écologie, à l’INRA.
![]()
Postes vedettes
- Doyen(ne), Faculté de médecine et des sciences de la santéUniversité de Sherbrooke
- Chaire de recherche du Canada, niveau 2 en génie électrique (Professeur(e))Polytechnique Québec
- Droit - Professeur(e) remplaçant(e) (droit privé)Université d'Ottawa
- Littératures - Professeur(e) (Littérature(s) d'expression française)Université de Moncton
- Medécine- Professeur.e et coordonnateur.rice du programme en santé mentaleUniversité de l’Ontario Français
















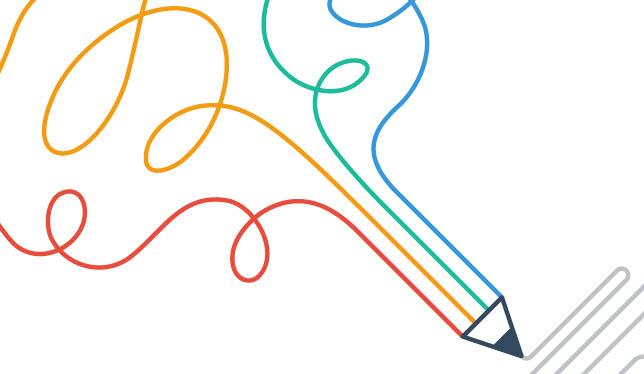

Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.